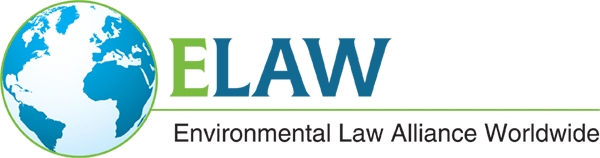Peuple autochtone U'wa et ses membres contre Colombie (4 juillet 2024)
La Cour interaméricaine des droits de l'homme (CIADH) a jugé que la Colombie avait violé les droits de propriété collective du peuple autochtone U'wa en ne lui accordant pas de titres de propriété complets et en autorisant diverses activités pétrolières, minières, touristiques et d'infrastructure sur son territoire sans consultation préalable. Le jugement a constaté des violations des droits à la propriété, à la participation, à l'accès à l'information, à la participation à la vie culturelle, à la liberté d'expression et de réunion, aux droits de l'enfant, à l'autodétermination des peuples autochtones et tribaux, à un environnement sain, à une vie digne et à l'intégrité personnelle du peuple autochtone U'wa et de ses membres. L'affaire concernait la militarisation et le recours à la force sur le territoire U'wa, notamment des rapports faisant état d'expulsions, de détentions, d'enlèvements, de meurtres de militants et de destruction de sites sacrés. Paragraphes 94 à 97.
Le droit à la priorité collective des communautés autochtones et tribales
Dans son analyse au fond, la Cour a réaffirmé les droits de propriété des peuples autochtones sur leurs territoires ancestraux, essentiels à leurs cultures, à leur vie spirituelle et à leur économie [para. 122–124], obligeant les États à garantir ce droit par la délimitation, la démarcation et l’attribution de titres de propriété pour garantir la sécurité juridique. Para. 126.
La Cour a souligné que la garantie de la propriété communautaire implique le respect de l'autonomie et de l'autodétermination des peuples autochtones, exigeant des États qu'ils adaptent leur droit interne et reconnaissent leur personnalité juridique. Paragraphe 129. Elle a également réitéré que les droits de propriété peuvent être soumis à des limitations établies par la loi, à condition qu'elles soient nécessaires, proportionnées et poursuivent un objectif légitime dans une société démocratique. Paragraphe 130.
Français Conformément à ces normes jurisprudentielles, la Cour a estimé que les mesures prises pour clarifier les titres fonciers coloniaux étaient insuffisantes, malgré les engagements pris et la disponibilité des informations pertinentes. Para. 135. Bien que certaines mesures aient été adoptées pour titrer le Resguardo Unido U'wa [para. 139], le processus est resté incomplet plus de 23 ans plus tard. Para. 141.
Français Concernant le chevauchement entre le Parc National El Cocuy et le territoire U'wa, la Cour a noté qu'« en principe, il existe une compatibilité entre les zones naturelles protégées et les droits des peuples autochtones » [para. 146], à condition que l'État garantisse une participation effective, l'accès aux terres traditionnelles et des avantages conformes aux objectifs de conservation. Para. 146. Après avoir examiné l'affaire, la Cour a observé que la participation du peuple U'wa à l'administration du Parc était sporadique [para. 155], et que les avantages découlant de la gestion et de la conservation de la zone protégée par l'État n'étaient pas démontrés. Para. 156.
En réponse aux revendications selon lesquelles les U'wa ont des droits sur les ressources naturelles de leur territoire, la Cour a statué que les droits de propriété peuvent être restreints si la survie des autochtones n'est pas menacée et que des garanties garantissent la compatibilité des droits de l'homme pendant les activités d'exploration ou d'exploitation. Para. 158.
En conséquence, la Cour a déclaré une violation du droit à la propriété collective en raison de l'échec de l'État à clarifier les titres fonciers coloniaux, de l'attribution incomplète des titres des Resguardos d'U'wa et de Kuitia, et du manque de participation continue et d'avantages clairs dans la gestion du parc national El Cocuy. Para. 159.
Droit à la consultation préalable
La controverse relative au respect de l'obligation de consultation préalable concernait sept projets. Concernant ceux réalisés dans le Resguardo d'U'wa, l'État a affirmé avoir mené des processus de consultation, ce qui a incité la Cour à évaluer la conformité de ces processus aux normes interaméricaines. La Cour a conclu que l'État avait violé les droits à la propriété collective, à la participation, à l'accès à l'information et à la participation à la vie culturelle en ne menant pas de consultations préalables adéquates, libres et éclairées concernant les projets d'extraction dans les blocs Samoré et Siriri-Catleya, situés dans le Resguardo d'U'wa. Paragraphe 224.
Dans l'affaire du bloc Samoré, la Cour a constaté que l'État n'avait pas cherché à parvenir à un accord lié à l'approbation de la mesure administrative soumise à consultation, mais s'était contenté d'informer la communauté d'une décision déjà prise, réduisant la consultation à une simple formalité. Paragraphes 185 et 183. Elle a cité une réunion au cours de laquelle un représentant du gouvernement a déclaré : « La consultation n'a pas pour objet de permettre au peuple U'wa de dire oui ou non, ni d'assumer cette responsabilité, qui incombe au gouvernement… ». Paragraphe 183.
Concernant les blocs Siriri-Catleya, l'État a soutenu que le droit à la consultation avait été éteint en raison du refus du peuple U'wa de participer au processus [para. 189], et la Cour a convenu que :
Dans les cas où l’État a initié une consultation de bonne foi et conformément aux normes… et que les peuples autochtones refusent de participer, ce refus doit être compris comme une opposition à l’activité en question, et par conséquent l’obligation de consulter est considérée comme remplie. . . . Para. 191.
Dans le cas d'espèce, le processus de consultation était déficient, car il n'a pas respecté « les coutumes, les traditions et la représentation du peuple U'wa, bien que l'État ait eu connaissance des autorités qui auraient dû être consultées ». Paragraphe 193. La Cour a noté que cela avait porté atteinte à la bonne foi entre les parties et conduit à l'échec du processus de consultation [paragraphe 192], et a rejeté l'argument de l'État invoquant la « doctrine de la quatrième instance ». Paragraphe 194.
Quant aux titres miniers accordés dans le Resguardo U'wa — plus précisément la concession GKT-081 —, la Cour a reconnu que l'obligation de consultation avait été respectée compte tenu du refus du peuple U'wa d'être consulté. La Cour a insisté sur la position du peuple U'wa de « ne pas exploiter les ressources naturelles sur son territoire » [para. 196] et a souligné que, même dans de tels cas, l'État doit veiller à ce que les mesures adoptées soient proportionnées et non discriminatoires. Para. 198. En conséquence, la Cour a conclu que le droit à la consultation n'avait pas été violé en ce qui concerne la concession minière GKT-081. Para. 199.
L'État a également contesté l'obligation de consultation pour les projets situés hors du Resguardo U'wa. La Cour a réitéré que la consultation est requise pour les projets ou mesures susceptibles d'affecter les droits d'un peuple autochtone ou tribal [para. 201], même si ces projets sont situés hors de son territoire. Elle a souligné que :
. . . l’« impact » qu’un peuple ou une communauté autochtone peut subir du fait de projets d’extraction peut inclure des projets situés exclusivement à l’extérieur de leur territoire, lorsque leur mise en œuvre peut avoir un effet direct sur les droits des communautés autochtones. Para. 201.
Français La Cour a ensuite analysé si les projets extérieurs au Resguardo U'wa étaient susceptibles d'affecter les droits du peuple U'wa, si l'État était conscient de l'impact potentiel et s'il avait une obligation de consultation. Plus précisément, elle a estimé que les projets Gibraltar 1, Gibraltar 3 et le gazoduc Gibraltar-Bucaramanga auraient dû faire l'objet d'une consultation, compte tenu de leur proximité avec le Resguardo et de la reconnaissance officielle de leur impact potentiel. Paragraphes 208, 210. Concernant la zone de forage exploratoire (Área de Perforación Exploratoria, APE) de Magallanes, puisqu'elle faisait partie du bloc Sirirí, pour lequel l'État a reconnu la nécessité de mener une consultation, il était également raisonnable de conclure que la consultation était requise. Paragraphe 216.
Étant donné que des processus de consultation adéquats n’ont pas été menés pour ces projets, la Cour a conclu que l’État a également violé les droits à la participation, à l’accès à l’information et à la participation à la vie culturelle en relation avec le droit à la propriété collective. Paragraphe 224.
Droits à la liberté d'expression, de réunion, droits des enfants et droit à l'autodétermination des peuples autochtones et tribaux
La Cour a analysé les allégations du peuple U'wa concernant le recours à la force par l'État pour expulser et réprimer des manifestations pacifiques. Elle a notamment examiné une manifestation au cours de laquelle environ 450 U'wa ont bloqué une route en signe d'opposition aux activités d'exploration pétrolière dans le bloc de Samoré. La manifestation a été dispersée par l'armée au gaz, faisant trois morts et plusieurs blessés. Paragraphes 241-242.
La Cour a conclu que l'État avait violé les droits à la liberté d'expression, de réunion, d'autodétermination et les droits de l'enfant en restreignant ces droits sans fournir suffisamment d'informations sur la base légale du recours à la force publique et sans démontrer la nécessité et la proportionnalité des mesures prises. Paragraphes 251, 246 et 247. Elle a également constaté qu'aucune mesure de protection spéciale n'avait été adoptée pour les mineurs pendant l'opération. Paragraphe 250.
Droit de participer à la vie culturelle
Français La Cour a affirmé que le droit des peuples autochtones à la vie culturelle inclut leur lien spirituel et culturel à la terre et au territoire, exigeant des États qu'ils empêchent toute ingérence, même de la part de tiers. Para. 271. Dans le cas du peuple U'wa, la Cour a noté que des activités extractives ont été menées sur leur territoire et les zones adjacentes depuis 1994. Para. 273. Après avoir examiné la cosmovision U'wa, la Cour a reconnu que « le pétrole et les autres ressources naturelles, y compris celles souterraines, ont une signification traditionnelle fondamentale pour [leur] culture », étant considérés comme le sang de la Terre Mère. Para. 277.
La Cour a jugé que l'État avait violé leurs droits culturels en autorisant ces activités sans considération appropriée, alors même qu'il était conscient des liens culturels, spirituels et ancestraux qui unissent le peuple U'wa à son territoire et à ses composantes. Paragraphes 281, 280, 278. La Cour a également constaté une violation de ce droit en raison de l'autorisation par l'État d'activités écotouristiques dans le parc national du Cocuy, un lieu revêtant une importance spirituelle particulière pour les U'wa. Paragraphes 286, 282. En revanche, elle n'a trouvé aucune preuve de la présence d'unités militaires dans le parc ou dans le Resguardo. Paragraphe 287.
Droit à un environnement sain
La Cour s'est référée à divers instruments internationaux et principes clés tels que la prévention, la précaution, l'équité intergénérationnelle et le devoir de l'État de réglementer, de superviser et de surveiller les activités susceptibles de causer des dommages environnementaux importants. Paragraphes 293 à 297.
Plus précisément, la Cour a souligné que les États ont le devoir de protéger à la fois les zones de réserve naturelle et les territoires traditionnels, afin de prévenir les dommages environnementaux, y compris ceux causés par des acteurs privés et des sociétés, grâce à des mécanismes appropriés de surveillance et de réglementation. Para. 297.
La Cour a fait référence à l'obligation de réaliser des études d'impact environnemental (EIE) pour les impacts et risques potentiels associés à un projet, y compris les effets cumulatifs, à la lumière de la « triple crise planétaire ». Paragraphes 298, 300 et 304.
La triple crise planétaire fait référence aux effets interconnectés et combinés de trois menaces mondiales : la pollution environnementale, la perte de biodiversité et la crise climatique résultant de l’extraction et de l’utilisation des combustibles fossiles et des émissions de méthane. Paragraphe 304.
Dans l'affaire U'wa, la Cour a conclu que l'État avait violé le droit à un environnement sain en ne faisant pas preuve de la diligence requise lors de l'approbation des EIE et en ne démontrant pas avoir pris des mesures d'atténuation à la suite du bombardement de l'oléoduc Caño Limón–Coveñas. Para. 328. La Cour a notamment observé que « le fait que l'État colombien ait approuvé des études d'impact environnemental ne suffit pas, en soi, à garantir le droit à un environnement sain », car ces études doivent répondre à certains critères. Para. 308.
La Cour a constaté que les études avaient été approuvées avant la réalisation des activités [para. 309] et qu'elles avaient été menées par des entités indépendantes sous la supervision de l'État. Para. 310. Cependant, la Cour a souligné que l'État avait autorisé le démarrage des opérations dans la zone de forage exploratoire de Magallanes (APE Magallanes) en tant que segment distinct du bloc Sirirí, violant ainsi les normes environnementales et n'ayant pas évalué adéquatement les impacts cumulatifs. Para. 311.
La Cour considère que la division du projet en parties a permis que, en évaluant indépendamment les composantes d’un projet intégral, les seuils minimaux requis pour une évaluation environnementale en fonction des impacts que le projet dans son ensemble peut présenter n’aient pas été atteints, évitant ainsi une évaluation du projet dans son ensemble. . . . Para. 311.
Français La Cour a également souligné l'importance de la participation du public — en particulier des peuples autochtones — au processus d'EIE [paras. 312–314], et a noté que les traditions et la culture des U'wa n'avaient pas été suffisamment prises en compte dans deux des projets. Paras. 315, 317. Enfin, étant donné qu'aucune activité n'avait été menée et qu'aucun permis n'avait été accordé pour le bloc Catleya et les projets miniers, des EIE n'étaient pas requises dans ces cas. Para. 318.
Concernant les déficiences en matière de surveillance et d'inspection, la Cour n'a constaté aucune preuve générale de non-respect. Paragraphe 319. Elle a souligné que « en l'espèce, il n'existe aucune preuve de dommages environnementaux significatifs résultant de l'exploitation des projets d'extraction, à l'exception de l'oléoduc Caño Limón–Coveñas ». Paragraphe 320. En l'espèce, bien que les dommages dus à la pollution et aux dommages environnementaux aient été établis, la Cour n'a pas imputé la responsabilité internationale à l'État, les actes ayant été causés par des tiers. Paragraphe 321.
Français Selon la Cour, l'obligation de l'État de prendre des mesures de prévention et de protection concernant les tiers dépend de sa connaissance du risque et de sa capacité raisonnable à le prévenir ou à l'atténuer. Para. 322. Dans cette affaire, l'État était conscient du risque, étant donné plus de 850 attaques sur l'oléoduc depuis 1986, mais la Cour n'a pas pu déterminer si les mesures préventives de l'État étaient suffisantes. Para. 323. La Cour a noté qu'en 2014, Ecopetrol a activé un plan d'urgence, a commencé le nettoyage et la restauration de l'environnement et a enterré l'oléoduc à la demande de l'État. Cependant, elle a jugé insuffisantes les preuves que l'État a utilisé des mesures efficaces ou une technologie appropriée pour atténuer les dommages. Para. 326. Ainsi, elle a conclu que le droit à un environnement sain avait été violé (Article 26 en liaison avec l'Article 1.1 de la Convention américaine).
Droits à la vie, à l'intégrité personnelle et à l'égalité devant la loi
La Cour a estimé que les faits et violations décrits précédemment ont causé souffrance et peur parmi les membres de la communauté U'wa, constituant une violation de leur droit à une vie digne et à l'intégrité personnelle (articles 4.1 et 5 en lien avec 1.1 de la Convention américaine). Para. 344. Cependant, elle a conclu qu'il n'y avait aucune omission prouvée de la part de l'État dans l'accomplissement de son devoir de garantir le droit à l'égalité et l'interdiction de la discrimination, soulignant diverses mesures adoptées par l'État au fil du temps. Para. 345 et 346.
Droits aux garanties judiciaires et à la protection judiciaire en relation avec le droit à l'égalité devant la loi
La Cour a évalué l'adéquation et l'efficacité des recours juridiques intentés par le peuple U'wa, notamment en matière de permis environnementaux. Elle a conclu à l'absence de responsabilité internationale de l'État concernant les actions en tutelle et en nullité intentées contre les permis du bloc d'exploration de Samoré et de la zone de forage exploratoire de Gibraltar (APE Gibraltar), les délais étant raisonnables, les décisions bien motivées et les divergences jurisprudentielles ne constituant pas, en elles-mêmes, une violation du droit à la protection juridictionnelle. Paragraphes 386, 363–373.
Toutefois, la Cour a jugé que l'État avait violé la garantie du délai raisonnable dans l'action en nullité de la licence de l'APE Magallanes et a constaté un manque d'effectivité de la décision du Tribunal administratif de Cundinamarca, car la consultation préalable qu'il avait ordonnée n'a pas été réalisée. Paragraphes 386, 374–384.
Conclusions et réparations
Pour toutes ces raisons, la Cour a déclaré la Colombie responsable de la violation des droits à la propriété collective, à la participation, à l’accès à l’information, à la participation à la vie culturelle, à la liberté d’expression et de réunion, aux droits de l’enfant, au droit à l’autodétermination des peuples autochtones, au droit à un environnement sain, à une vie digne et à l’intégrité personnelle, ainsi qu’aux garanties judiciaires et à la protection judiciaire (articles 21, 23, 13, 26, 15, 19, 4.1, 5, 8, 25 et 1.1 de la Convention américaine).
Enfin, la Cour a ordonné à l'État de prendre les mesures nécessaires pour procéder à la démarcation complète du Resguardo Unido U'wa et du Resguardo Kuita [p. 143, point 10], et de clarifier les titres fonciers coloniaux. P. 143, point 11. Il a également été ordonné à l'État d'impliquer le peuple U'wa dans l'administration et la conservation de la zone de chevauchement entre le parc national El Cocuy et le Resguardo U'wa [p. 143, point 12], et de mener un processus participatif concernant les projets d'extraction en cours. P. 144, point 13.
Français En plus d'adopter des mesures d'atténuation pour les dommages environnementaux causés par les explosions le long de l'oléoduc Caño Limón-Coveñas [p. 144, point 14], la Cour a ordonné des mesures de satisfaction, comme un acte public reconnaissant la responsabilité internationale de l'État. P. 144, point 15. Elle a également ordonné la résolution des procédures judiciaires en cours, la création d'un fonds de développement communautaire et le remboursement des frais et dépens juridiques, y compris ceux du Fonds d'assistance juridique aux victimes de la Cour interaméricaine P. 144, points 16, 17 et 18.