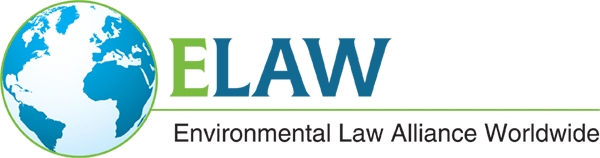L'impact de la connectivité des écosystèmes sur la résilience des récifs coralliens
Numéro d'étude :
10
Auteur:
PJ Mumby et A. Hastings
Abstrait:
- La dispersionntogénétique des animaux a été observée dans de nombreux écosystèmes, mais sa signification écologique dans son intégralité est mal comprise. En modélisant les conséquences de la dispersion internalisée des poissons de récif entre les mangroves des Caraïbes et les récifs coralliens adjacents, nous quantifions les implications plus larges de la connectivité des écosystèmes sur le fonctionnement et la résilience des écosystèmes aux perturbations dues au climat (changement climatique).
- L'enrichissement par les mangroves des poissons perroquets broutant sur deux habitats de récifs coralliens a été calculé à l'aide de données empiriques. Les conséquences d’un pâturage accru ont ensuite été étudiées à l’aide d’une simulation spatiale de la dynamique des récifs coralliens dans les avant-récifs peu profonds (profondeur 3 à 6 m) et à mi-plateau (profondeur 7 à 15 m).
- La plus forte augmentation du pâturage s'est produite dans les récifs peu profonds, mais elle a eu des conséquences négligeables sur la dynamique des populations de coraux.
- En revanche, une augmentation relativement faible du pâturage sur les récifs plus profonds a eu de profondes conséquences : les récifs proches des mangroves ont pu connaître une récupération corallienne sous les régimes d'ouragans les plus intenses des Caraïbes, tandis que ceux dépourvus de connectivité écosystémique avaient peu de capacité de récupération.
- Ce résultat surprenant se produit parce que les récifs présentent de multiples équilibres stables et que l’enrichissement du pâturage par les mangroves dans les récifs du milieu du plateau coïncide avec une zone d’instabilité du système. Une légère augmentation du pâturage a déplacé le récif au-delà d’un point de bifurcation, améliorant ainsi considérablement la résilience. Une augmentation relativement importante du pâturage dans les récifs peu profonds a eu des conséquences minimes sur l'écosystème car les niveaux de pâturage concernés étaient plus du double des niveaux nécessaires pour dépasser le point de bifurcation correspondant pour cet habitat.
- Synthèse et applications, les mangroves des Caraïbes sont en cours déforesté à un rythme plus rapide que les forêts tropicales, mais leur rôle protecteur contre les dommages causés par les ouragans s'étend non seulement vers les environnements côtiers, mais également vers la mer, en augmentant la résilience des récifs coralliens au large. Plus précisément, les mécanismes ontogénétiques de connectivité des écosystèmes impliquant les poissons-perroquets peuvent augmenter la probabilité que les populations de coraux se rétablissent de changements induits par le climat dans les perturbations causées par les ouragans. Efforts pour arrêter la mangrove la déforestation et la restauration des habitats de mangroves augmenteront probablement la probabilité de rétablissement des coraux sur les récifs de profondeur moyenne (7 à 15 m) après une perturbation. En général, les conséquences de la migration ontogène au niveau de l'écosystème ne correspondent pas nécessairement à l'ampleur des effets observés localement (c'est-à-dire que le schéma d'enrichissement des pâturages présentait le schéma opposé à celui de ses conséquences sur la résilience du système). Par conséquent, il faut faire preuve de prudence lors de l'interprétation de l'importance fonctionnelle des changements dans l'abondance des espèces pour les processus écosystémiques (par exemple la pression de pâturage et ses implications sur la croissance et la survie des coraux). Les impacts d’un changement d’abondance ou de processus sont peut-être mieux appréciés à l’aide de modèles mécanistes d’écosystèmes.
Principaux résultats et conclusions :
- « Ici, nous émettons l'hypothèse que la réponse des populations de coraux à l'augmentation du pâturage sera plus grande dans les habitats qui bénéficient le plus fortement de la connectivité mangrove-récif » (855).
- Cette étude a utilisé un modèle de simulation de la dynamique des récifs coralliens « pour étudier les conséquences au niveau de l’écosystème des densités élevées de poissons-perroquets dans les récifs connectés aux écosystèmes de mangroves (Fig. 1) » (855).
- Dans les écosystèmes récifaux du milieu du plateau, une espèce de poisson en particulier, Scarus iserti dépendait fortement de l’habitat des mangroves : « La connectivité des mangroves a augmenté la biomasse des Scarus iserti en Méso-Amérique par 42%, mais n'a pas influencé la densité d'autres espèces de poissons-perroquets dans cet habitat (Mumby et autres. 2004). Le changement de biomasse qui en résulte est responsable d'une augmentation 50% de l'intensité du pâturage des S. iserti dans les systèmes de mangroves riches (0,14% h –1 à 0,21% h –1 dans les systèmes pauvres et riches, respectivement, en moyenne sur trois systèmes de la taille d'un atoll dans chaque traitement). Bien que S. iserti est l'une des plus petites espèces de poissons-perroquets, atteignant généralement une longueur totale d'environ 20 cm, c'est aussi la plus abondante. En moyenne, S. iserti représente 20% de l’intensité totale de pâturage des poissons-perroquets sur les récifs sans connectivité aux mangroves (en moyenne sur 30 sites récifaux des Bahamas et du Belize). Si la contribution de S. iserti à l'impact total du pâturage dans les systèmes pauvres en mangroves (soit 30% du récif 6 mois –1) est isolé (soit 20% sur 30, soit six) et enrichi par 50% (soit trois unités d'impact pâturage), l'impact total effectif du pâturage dans les récifs du milieu du plateau enrichis en mangroves, s'élève à 33% 6 mois –1. En d’autres termes, la connectivité des mangroves augmente l’impact total du pâturage des communautés de poissons-perroquets sur les récifs du milieu du plateau d’environ 10% (de 30% à 33% du récif) » (855).
- Dans les écosystèmes récifaux peu profonds, S. guacamaia dépendait fortement de l’habitat des mangroves : « Le principal impact des mangroves sur les récifs peu profonds est le soutien des adultes. S. guacamaia (Maman et autres. 2004 ; Dorenbosch et autres. 2006)…Comme les poissons individuels n'ont pas pu être récoltés, l'impact du pâturage S. guacamaia a été modélisé en supposant que l'échelle allométrique de la taille de la bouchée avec la taille du corps se maintenait au sein des genres. Les taux de morsure et les domaines vitaux ont été déterminés en suivant huit individus à Bonaire et à Belize pendant une période de 2 minutes. Les observations du taux de morsure avaient une précision raisonnablement élevée [erreur type (SE)/moyenne] inférieure à 20% (Andrew & Mapstone 1987). Un domaine vital de 1 600 m2 (estimé de manière prudente) est plus grand que celui de nombreux autres scaridés (Mumby & Wabnitz 2002), et le pâturage par cette espèce représente environ 141 TP3T de l'intensité totale de pâturage mesurée pour les systèmes appauvris de mangroves (0·041% h–1 de 0·302% h–1). En augmentant l’impact total du pâturage pour les récifs peu profonds (49% 6 mois-1) de cette proportion, on obtient un nouvel impact de 56% 6 mois-1. Combiner les contributions des deux S. guacamaia et S. iserti Le pâturage dans les récifs peu profonds riches en mangroves donne un impact total de pâturage de 57% 6 mois-1, ce qui représente un enrichissement global de 16% (huit/49) » (858).
- Les modèles ont montré que les mangroves agissant comme une aide incroyable à la récupération des récifs coralliens après des phénomènes naturels tels que les ouragans : « Sous d’intenses perturbations décennales liées aux ouragans, les récifs dotés d’une connectivité avec les mangroves ont réussi à atteindre des niveaux élevés de couverture corallienne (> 50%), quel que soit l’état initial de la zone. récif (Fig. 4b). De plus, cet impact sur la résilience basé sur les mangroves était supérieur à la réduction de moitié de la fréquence des ouragans sur un récif pauvre en mangroves. En revanche, les récifs dépourvus de connectivité avec les mangroves avaient peu de potentiel de rétablissement et atteignaient une couverture corallienne bien inférieure. Par exemple, les récifs commençant avec une couverture relativement malsaine de 10% ont montré peu de capacité à s'améliorer après 50 ans (Fig. 4b). Même lorsque les récifs ont commencé avec un corail 30% sain (selon les normes actuelles), il n'y a pas eu d'augmentation nette de la couverture » (859).
Ouvrages cités:
Andrew, NL & Mapstone, BD (1987) Échantillonnage et description de la configuration spatiale en écologie marine. Revue annuelle d'océanographie et de biologie marine, 25, 39-90.
Mumby, PJ, Edwards, AJ, Arias-Gonzalez, JE, Lindeman, KC, Blackwell, PG, Gall, A., Gorczynska, MI, Harborne, AR, Pescod, CL, Renken, H., Wabnitz, CCC et Llewellyn, G. (2004) Les mangroves améliorent la biomasse des communautés de poissons des récifs coralliens dans les Caraïbes. Nature, 427, 533-536.
Mumby, PJ & Wabnitz, CCC (2002) Modèles spatiaux d'agression, taille du territoire et taille du harem chez cinq espèces sympatriques de poissons-perroquets des Caraïbes. Biologie environnementale des poissons, 63, 265-279.