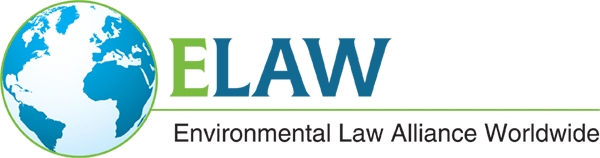Barrières naturelles face aux catastrophes naturelles : replanter des mangroves après le tsunami
Auteur:
E.B. Barbier
Abstrait:
La catastrophe du tsunami de décembre 2004 dans l'océan Indien a accru l'intérêt pour la replantation des zones de mangroves dégradées et déboisées en Asie afin d'améliorer la protection des côtes. Des données provenant de Thaïlande suggèrent que les inquiétudes suscitées par la déforestation des mangroves par les élevages de crevettes (pisciculture) constitue une motivation importante pour de nombreux ménages côtiers à participer à la réhabilitation des mangroves. Cependant, le rétablissement et la gestion réussis des mangroves en tant que barrières côtières efficaces nécessiteront le développement de nouvelles institutions et politiques, et devront impliquer les communautés côtières de Thaïlande et d'autres pays de l'océan Indien dans la conservation et la protection de leurs forêts de mangroves locales.
Principaux résultats et conclusions :
- Déterminer si les efforts de reboisement des mangroves seront couronnés de succès implique d’examiner de nombreux aspects :
- L’injustice environnementale est communément associée à l’élevage de crevettes : « … il est peu probable que les principaux responsables de la destruction passée des mangroves soient impliqués dans les efforts de replantation et de restauration. Au lieu de cela, la plupart des programmes de replantation actuels dépendent de la participation des communautés côtières les plus touchées par la perte des forêts de mangroves locales » (125).
- La FAO a sous-estimé les forêts de mangrove restantes en Thaïlande par rapport aux études du Département royal des forêts de Thaïlande, par exemple, ~2 500 km2 contre ~1 650 km2 pour 2004 (125).
- Coûts externes associés à pisciculture les opérations posent de graves problèmes aux communautés locales : pollution de l’eau, durée de vie courte de la production développement côtier et abandon, aucune obligation légale de replanter déforesté zones géographiques et d’importantes subventions (126).
- Les conditions de libre accès ont un impact sur la mangrove la déforestation: le libre accès rend les habitats des mangroves plus vulnérables aux attaques illégales pisciculture ainsi que les opérations d'exploitation forestière et de copeaux de bois. De plus, les zones d’accès libre font que les populations locales n’ont que peu de mot à dire sur le sort des forêts de mangrove, bien qu’elles en dépendent pour leurs moyens de subsistance (126).
- Un résumé des efforts de replantation de la Thaïlande est le suivant (126):
- « …les programmes de replantation antérieurs en Thaïlande et dans d'autres pays asiatiques ont largement fonctionné dans le cadre juridique et institutionnel existant qui n'exige pas que les principaux responsables de la mangrove la déforestation… »
- « …les gouvernements et/ou les organisations non gouvernementales financent les plans de réhabilitation, en particulier lorsque cela nécessite l'acquisition d'équipements lourds et d'entrepreneurs en ingénierie pour reconvertir et préparer les étangs abandonnés et autres terres dégradées à la restauration.
- « Les communautés locales sont généralement limitées à fournir la main d’œuvre pour les tâches manuelles telles que l’entretien des pépinières, la plantation des plants et le désherbage. »
- La participation locale aux efforts de replantation de mangroves étudiée dans quatre villages de Thaïlande à partir de l'étude Barbier de 2006 a indiqué que les hommes étaient davantage impliqués dans les efforts de replantation, jusqu'à 62 heures par an étaient consacrées à la replantation dans le village de Ban Gong Khong, et que comme à peine 0% du village de Ban Sam Chong Tai voulait des élevages de crevettes dans les villages (Tableau 1, 128). « Les résultats de l'analyse confirment que le degré de dépendance des ménages aux activités liées aux mangroves pour leurs revenus est un facteur majeur déterminant si les ménages participent aux programmes de réhabilitation des mangroves » (128).
- Suggestions pour une gestion durable des mangroves (citées dans l'article de Barbier & Sathirathai 2004) (129-130) :
- Les zones de mangrove restantes devraient être classées soit comme zones de conservation, soit comme zones économiques. Les élevages de crevettes devraient être limités aux zones économiques, mais les communautés locales qui dépendent des écosystèmes de mangroves pour leur subsistance devraient y avoir accès.
- Établir des forêts de mangroves communautaires dans les zones de conservation et les zones économiques. La gestion locale des forêts de mangrove sous forme de droits d'utilisation devrait être accordée en fonction des capacités de gestion communautaire.
- La cogestion entre les communautés locales et le gouvernement devrait exister pour les forêts communautaires.
- Le gouvernement devrait fournir un soutien complet aux communautés locales participant à la conservation des mangroves (c'est-à-dire technique, éducatif, financier).
Ouvrages cités:
Barbier, EB 2006. Dépendance aux mangroves et moyens de subsistance des communautés côtières en Thaïlande. Dans : Hoanh CT, Tuong TP, Gowing JW et Hardy W (Eds). Environnement et moyens de subsistance dans les zones côtières tropicales : gestion des conflits entre agriculture, pêche et aquaculture. Wallingford, Royaume-Uni : CAB International.
Barbier, EB et S. Sathirathai 2004. Conclusion de l'étude et recommandations politiques. Dans : Barbier EB et Sathirathai S (Eds). Élevage de crevettes et perte de mangrove en Thaïlande. Londres, Royaume-Uni : Edward Elgar.
FAO (Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture). 2003. Statut et tendances de l'étendue des mangroves dans le monde. Rome, Italie : Département des Forêts. Document de travail sur l'évaluation des ressources forestières 63.