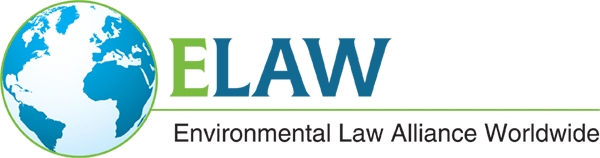Forêts de mangrove : résilience, protection contre les tsunamis et réponses au changement climatique mondial
Numéro d'étude :
55
Auteur:
DM Alongi
Abstrait:
Cette étude évalue le degré de résilience des forêts de mangroves à des perturbations importantes et peu fréquentes (tsunamis) et leur rôle dans la protection des côtes, ainsi qu'aux événements de perturbations chroniques et l'avenir des mangroves face aux changements climatiques mondiaux. (changement climatique. D’un point de vue géologique, les mangroves vont et viennent à une vitesse considérable, la répartition actuelle des forêts étant un héritage de l’Holocène, ayant subi des perturbations quasi chroniques dues aux fluctuations du niveau de la mer. Les mangroves ont fait preuve d’une résilience considérable sur des échelles de temps proportionnelles à l’évolution du littoral. Cette notion est étayée par la preuve que les taux d'accrétion des sols dans les forêts de mangrove suivent actuellement le rythme de l'élévation du niveau moyen de la mer. Leur résilience vient également des modèles de rétablissement après des perturbations naturelles (tempêtes, ouragans) qui, associés à des traits clés de l'histoire de vie, suggèrent des caractéristiques de phase pionnière. La composition des peuplements et la structure forestière sont le résultat d'une interaction complexe de tolérances physiologiques et d'interactions compétitives conduisant à une mosaïque de séquences de succession interrompues ou arrêtées, en réponse aux gradients physiques/chimiques et aux changements de relief. La mesure dans laquelle tout ou partie de ces facteurs entrent en jeu dépend de la fréquence, de l’intensité, de l’ampleur et de la durée de la perturbation. Les mangroves peuvent, dans certaines circonstances, offrir une protection limitée contre les tsunamis ; Certains modèles utilisant des variables forestières réalistes suggèrent une réduction significative de la pression du débit des vagues du tsunami pour les forêts d'au moins 100 m de largeur. L'ampleur de l'absorption d'énergie dépend fortement de la densité des arbres, du diamètre des tiges et des racines, de la pente du rivage, de la bathymétrie, des caractéristiques spectrales des ondes incidentes et du niveau de marée à l'entrée de la forêt. La perturbation ultime, changement climatique, peut entraîner une perte globale maximale de 10–15% de forêt de mangrove, mais doit être considéré comme d'importance secondaire par rapport aux taux annuels moyens actuels de 1–2% la déforestation. Un vaste réservoir de nutriments souterrains, des taux rapides de flux de nutriments et de décomposition microbienne, des contrôles biotiques complexes et très efficaces, l'auto-conception et la redondance des espèces clés, ainsi que de nombreuses rétroactions, contribuent tous à la résilience des mangroves à divers types de perturbations.
Principaux résultats et conclusions :
- Les tendances historiques ne sont pas de bons indicateurs pour savoir si les mangroves seront capables ou non de suivre la montée du niveau de la mer (2-4).
- Le temps de récupération des mangroves après une perturbation varie considérablement. Les facteurs qui affectent le rétablissement des mangroves comprennent la composition et la structure du peuplement, la tolérance physiologique aux gradients physico-chimiques, les changements géomorphologiques et les interactions compétitives (5).
- Le succès de la protection des mangroves contre les événements catastrophiques dépend de nombreux facteurs, notamment « du type de cadre environnemental et d'autres caractéristiques et conditions pertinentes »(6). Par exemple, les mangroves offrent une protection variable contre les tsunamis en fonction de «… la largeur de la forêt, la pente du sol forestier, la densité des arbres, le diamètre des arbres, la proportion de biomasse aérienne investie dans les racines, la hauteur des arbres, la texture du sol, l'emplacement de la forêt (côte ouverte vs.) lagon), le type de végétation et de couverture des basses terres adjacentes, la présence d'habitats d'estran (herbiers marins, récifs coralliens, dunes), la taille et la vitesse du tsunami, la distance par rapport à l'événement tectonique et l'angle d'incursion du tsunami par rapport au littoral »(6).
- L'article utilise le tsunami indonésien de 2004 comme étude de cas sur la capacité de protection des mangroves (6-7).
- Changement climatique peut avoir des impacts très graves sur l’habitat des mangroves. Changements environnementaux associés à changement climatique et leurs impacts relatifs sur l'habitat des mangroves comprennent :
- « Élévation du niveau de la mer : progression vers les terres, augmentation de la productivité secondaire due à une plus grande disponibilité de nutriments provenant de l'érosion,
- Augmentation du CO2 atmosphérique : floraison avancée, efficacité accrue de l’utilisation de l’eau, augmentation nulle ou faible de la production primaire et de la respiration.
- Augmentation de la température de l'air et de l'eau : diminution de la survie dans les zones d'aridité accrue, expansion des étendues latitudinales, augmentation de la production primaire nette et brute, augmentation du déficit de pression de vapeur d'eau, augmentation de la production secondaire (en particulier des microbes) et changement dans la dominance des espèces, changements dans les modèles phénologiques. de reproduction et de croissance, et une augmentation de la biodiversité
- Changement dans les modèles de précipitations/tempêtes, fréquence et intensité : changements dans la composition et la croissance des espèces de mangroves dus au changement de la teneur en eau du sol, de la salinité, augmentation de la production primaire due à l'augmentation du rapport précipitations/évaporation, changements sur la biodiversité faunique, augmentation des lacunes et des écarts. recrutement » (Tableau 2, p. 8 : Woodruffe 1990, Aksornkaoe & Paphavasit 1993, Pernetta 1993, PNUE 1994, Semeniuk 1994, Snedaker 1995, Miyagi et autres. 1999, Nicholls et autres. 1999, Hogarth 2001, Alongi 2002, Schaeffer-Novelli et autres. 2002, Done et Jones 2006 ; Gilman et coll. 2006).
- Certains écosystèmes de mangroves seront plus touchés que d’autres :
- « Les mangroves occupant des îles à faible relief et/ou des milieux carbonatés, où les taux d'apport de sédiments et l'espace disponible en altitude sont généralement faibles, comme sur les petites îles du Pacifique, sont les plus vulnérables. Les forêts où les rivières sont absentes et/ou où le relief s'affaisse sont également les plus vulnérables.
- « Les moins vulnérables, hormis ceux qui occupent les estuaires à macro-tidale, les zones tropicales humides et les rivages adjacents aux rivières, sont les peuplements occupant des îles à haut relief et des zones isolées où il est peu probable que les humains bloquent la migration vers la terre » (Figure 8, p. 10). : Wilkie & Fortuna 2003, Gilman et coll. 2006, PNUE-WCMC 2006, Salomon et coll. 2007).
Ouvrages cités:
Aksornkaoe, S., Paphavasit, N., 1993. Effet de l'élévation du niveau de la mer sur l'écosystème des mangroves en Thaïlande. Journal malaisien de géographie tropicale 24, 29–34.
Alongi, DM, 2002. État actuel et avenir des forêts de mangroves du monde. Conservation de l’environnement 29, 331–349.
Done, T., Jones, R., 2006. Écosystèmes côtiers tropicaux et prévision du changement climatique : risques mondiaux et locaux. Dans : Phinney, JT, Strong, A., Skrving, W., Kleypas, J., Hoegh-Guldberg, O. (Eds.), Récifs coralliens et changement climatique : science et gestion. Union géophysique américaine, Washington, DC, p. 5–32.
Gilman, E., Van Lavieren, H., Ellison, J., Jungblut, V., Wilson, L., Areki, F., Brighouse, G., Bungitak, J., Dus, E., Henry, M. , Sauni, I., Kilman, M., Matthews, E., Teariki-Ruatu, N., Tukia, S., Yuknavage, K., 2006. Les mangroves des îles du Pacifique dans un climat changeant et une montée des eaux. Rapports et études du PNUE sur les mers régionales n° 179. PNUE, Nairobi, 58 p.
Hogarth, PJ, 2001. Mangroves et changement climatique. Annuaire des océans 15, 331–349.
Miyagi, T., Tanavud, C., Pramojanee, P., Fijimoto, K., Mochida, Y., 1999. Dynamique de l'habitat des mangroves et changement du niveau de la mer. Tropiques 8, 179–196.
Nicholls, RJ, Hoozemans, FMJ, Marchand, M., 1999. Augmentation du risque d'inondation et des pertes de zones humides dues à l'élévation mondiale du niveau de la mer : analyses régionales et mondiales. Changement environnemental mondial 9, S69–S87.
Pernetta, JC, 1993. Forêts de mangroves, changement climatique et élévation du niveau de la mer : influences hydrologiques sur la structure et la survie des communautés, avec des exemples de l'Indo-Pacifique occidental. Rapport sur la conservation et le développement marins. UICN, Gland, Suisse, 46 p.
Schaeffer-Novelli, Y., Cintron-Molero, G., Soares, MLG, 2002. Les mangroves comme indicateurs du changement du niveau de la mer sur les côtes boueuses du monde. Dans : Healy, T., Wang, Y., Healy, J.-A. (Eds.), Côtes boueuses du monde : processus, dépôts et fonction. Elsevier, Amsterdam, p. 245.–262.
Semeniuk, V., 1994. Prédire l'effet de l'élévation du niveau de la mer sur les mangroves du nord-ouest de l'Australie. Journal de recherche côtière 10, 1050–1076.
Snedaker, SC, 1995. Mangroves et changement climatique dans la région de Floride et des Caraïbes : scénarios et hypothèses. Hydrobiologie 295, 43–49.
Solomon, S., Qin, D., Manning, M., Chen, Z., Marquis, M., Averyl, KB, Tignor, M., Miller, HL (Eds.), 2007. Climate Change 2007: The Physical Base scientifique. Contribution du Groupe de travail I au quatrième rapport d'évaluation du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Cambridge University Press, Cambridge, 1056 p.
Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE).1994. Évaluation et suivi des impacts du changement climatique sur les écosystèmes de mangrove. Rapports et études du PNUE sur les mers régionales n° 154. PNUE, Nairobi, 62 p.
PNUE-WCMC. 2006. En première ligne : protection des rivages et autres services écosystémiques provenant des mangroves et des récifs coralliens. PNUE-WCMC : Cambridge. 33 p.
Wilkie, ML et S. Fortuna. 2003. Statut et tendances de l'étendue des mangroves dans le monde. Document de travail sur l'évaluation des ressources forestières 63. Division des ressources forestières, FAO, Rome. http://www.fao.org/docrep/007/j1533e/J1533E00.htm.
Woodruffe, CD, 1990. L'impact de l'élévation du niveau de la mer sur les rivages des mangroves. Progrès en géographie physique 14, 483–520.