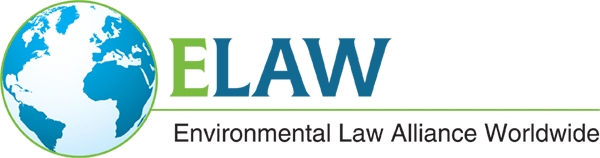Affaire Habitants de La Oroya c. Pérou, Cour interaméricaine des droits de l'homme (27 novembre 2023)
La Cour interaméricaine des droits de l'homme (CIADH) a statué en faveur de 80 victimes vivant à La Oroya après l'installation d'un complexe métallurgique, déclarant l'État péruvien responsable des violations des droits humains causées par les activités du complexe. L'arrêt a constaté des violations des droits à un environnement sain, à la santé, à la vie, à l'intégrité personnelle, à l'accès à l'information et à la participation politique, à un recours judiciaire effectif, aux droits de l'enfant et à l'obligation d'enquêter.
Faits prouvés
Les faits de l'affaire concernent le Complexe Métallurgique de La Oroya (CMLO), exploité depuis 1922 par diverses sociétés, dont Doe Run Peru SRL, filiale de la société américaine The Renco Group, Inc. Paragraphe 67. La Cour a souligné que la pollution atmosphérique est présente depuis le début des opérations du CMLO et que 99% de polluants atmosphériques à La Oroya proviennent de ce complexe. Paragraphes 76, 67.
La Cour a souligné les tentatives des victimes de demander une protection judiciaire au niveau national [paras. 86-88], les mesures conservatoires accordées par la Commission interaméricaine des droits de l'homme (CIDH) [paras. 89-91], ainsi que les actes de harcèlement et de menaces contre certaines victimes. Paras. 93-101.
Mérites
Obligations générales de l'État
La Cour a réaffirmé que les États ont le devoir de respecter et de garantir les droits de l’homme, ce qui inclut la prévention des violations par des acteurs privés [para. 109], au moyen d’une législation adéquate, d’un contrôle efficace et d’une enquête sur les faits. Paragraphes 112-113.
La Cour a établi une distinction entre la responsabilité de l’État pour les actes des entreprises publiques – directement attribués à l’État – et pour les actes des entreprises privées, où l’État a l’obligation de « réglementer, superviser et surveiller . . . . » Para. 156.
Droit à un environnement sain
Dans son analyse du droit à un environnement sain, la Cour a souligné à la fois les aspects procéduraux et substantiels, soulignant que « les États sont donc tenus de protéger la nature et l’environnement non seulement en raison des avantages qu’ils procurent à l’humanité, mais aussi en raison de leur importance pour les autres organismes vivants avec lesquels nous partageons la planète. » Para. 118.
Concernant la pollution de l'air et de l'eau, la Cour a souligné que l'État est tenu de réglementer les normes de qualité, de surveiller la qualité de l'air et de l'eau, d'informer la population des risques potentiels pour la santé et d'adopter des mesures préventives, toujours conformément aux meilleures données scientifiques disponibles. Paragraphes 119 à 121. La Cour a souligné l'importance du droit à l'eau en tant que droit autonome et son lien avec le droit à un environnement sain. Paragraphes 122 à 125.
La Cour a fait référence à des principes fondamentaux, tels que la prévention des dommages environnementaux, qui doit être mise en œuvre avec une diligence raisonnable proportionnelle au risque de préjudice. Paragraphe 126. Elle a également invoqué le principe de précaution [paragraphe 127] et l'équité intergénérationnelle. Paragraphe 128.
Il est difficile d'imaginer des obligations internationales plus importantes que celles qui protègent l'environnement contre les comportements illicites ou arbitraires causant des dommages environnementaux graves, étendus, durables et irréversibles, notamment dans le contexte de la crise climatique qui menace la survie des espèces. Dans ce contexte, la protection internationale de l'environnement exige la reconnaissance progressive de l'interdiction de tels comportements comme norme impérative.jus cogens), acceptée par la communauté internationale dans son ensemble comme une norme à laquelle aucune dérogation n’est permise . . . . Para. 129.
Français Dans le cas spécifique, la Cour a conclu que les activités métallurgiques de CMLO étaient la principale cause de pollution à La Oroya ; que le Pérou était conscient de cette pollution et que ces activités avaient un impact négatif sur l'air, le sol, l'eau et les habitants de La Oroya. Paragraphes 158 ; 170-176 ; 179 ; 263. Bien que le Pérou ait adopté une réglementation environnementale, il n'existait aucune réglementation spécifique pour la protection de l'environnement concernant les activités minières et métallurgiques jusqu'en 1993, ce qui constituait une violation du devoir de réglementation. Paragraphe 162.
Français En ce qui concerne la supervision et la surveillance, la Cour a estimé que l'État avait tardé à prendre des mesures [para. 163] et avait accordé des prolongations exceptionnelles à l'entreprise sans tenir compte de leur compatibilité avec les objectifs de la législation environnementale et sans tenir compte de la pollution dont il avait connaissance, laquelle exigeait une action immédiate de l'État. Para. 165-168. Cela a conduit à un manquement à « deux points centraux relatifs à son devoir de diligence raisonnable ». Para. 168. En fin de compte, la Cour a conclu que le droit à un environnement sain avait été violé, affirmant que les actions de l'État avaient causé des dommages environnementaux, tandis que ses omissions en matière de surveillance « ont permis que ces dommages perdurent après la privatisation de l'entreprise ». Para. 176. La Cour a estimé que « la gravité et la durée de la pollution produite par le CMLO pendant des décennies suggèrent que La Oroya a été utilisée comme une “zone de sacrifice”… » Para. 180.
La Cour a également conclu à la violation du développement progressif du droit à un environnement sain en raison de la modification délibérément régressive des normes de qualité de l’air en 2017. Paragraphes 187, 264.
Droit à la santé
La Cour a noté que la santé est « un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas simplement en une absence de maladie ou d’infirmité » [para. 133], qui est directement lié à l’accès à la nourriture et à l’eau, ainsi qu’à la protection contre les dommages environnementaux graves.
La Cour a souligné « des preuves solides des effets sur la santé de l'exposition à ces métaux » [plomb, cadmium, mercure, arsenic] [para. 189] ; que « la simple exposition à des niveaux élevés de polluants – tels que ceux produits par les activités de CMLO – présente un risque pour la santé humaine » [para. 205], et enfin que « l'exposition simultanée à différents agents polluants génère des risques cumulatifs pour la santé humaine ». Para. 205.
Dans l'affaire analysée, la Cour s'est référée à des études sur les concentrations sanguines de métaux lourds chez les habitants de La Oroya. Paragraphes 191 à 196. L'État a plaidé l'absence de lien de causalité entre les maladies des victimes et l'exposition aux polluants à La Oroya, et la Cour a convenu qu'« en réalité, les informations sont insuffisantes pour établir les concentrations des métaux susmentionnés dans le sang des victimes présumées pendant toute la période d'exposition à la pollution, ni la manière spécifique dont cette exposition a provoqué les maladies qu'elles ont contractées ». Paragraphe 203. Cependant, la Cour a noté que
Pour établir la responsabilité de l'État pour les violations du droit à la santé, il suffit de démontrer que l'État a autorisé des niveaux de pollution qui ont mis en danger de manière significative la santé humaine et que les personnes ont effectivement été exposées à une contamination environnementale telle que leur santé a été mise en péril. Para. 204.
Après que les victimes de l'affaire ont été exposées à des niveaux élevés de métaux lourds pendant des années et que leurs représentants ont démontré les maladies dont elles souffrent aujourd'hui en raison de cette exposition [para. 206], la Cour a conclu que le Pérou avait violé le droit à la santé. Para. 214. La Cour a également cité le principe de précaution, affirmant que « l'absence de certitude scientifique quant aux effets spécifiques que la pollution environnementale peut avoir sur la santé humaine ne saurait justifier que les États reportent ou évitent l'adoption de mesures préventives, ni justifier l'absence de mesures générales de protection de la population. » Para. 207.
En ce qui concerne les soins de santé, la Cour a observé que l’État n’avait pas fourni d’installations adéquates pour traiter les maladies liées à la pollution ; que les centres médicaux où des soins auraient pu être prodigués n’étaient pas accessibles aux victimes ; et que le type de traitement reçu n’était pas adéquat. Paragraphes 213, 264.
Droit à la vie et à l'intégrité personnelle
La Cour a rappelé sa jurisprudence sur le droit à la vie, notant que celui-ci implique des obligations positives pour les États, telles que la création d'un cadre juridique dissuasif contre les menaces à la vie, la mise en place d'un système judiciaire efficace et la garantie de conditions garantissant une vie digne, notamment l'accès à l'eau, à la nourriture, à la santé et à un environnement sain. Para. 136. La Cour a également noté qu'une vie digne est étroitement liée à l'intégrité personnelle. Para. 138.
Français Dans le cas spécifique, la Cour a tenu l'État responsable de la violation du droit à la vie de deux victimes décédées de maladies dues à des soins médicaux inadéquats. Par. 215-219, 264. En ce qui concerne la perturbation de la vie des 80 victimes, qui ont vécu pendant des années sans les conditions élémentaires d'une vie digne en raison de la pollution environnementale à La Oroya, la Cour a également constaté la violation du droit à une vie digne. Par. 220-223.
La Cour a rappelé que les victimes avaient subi des atteintes à leur intégrité personnelle en raison de l'intimidation et de la stigmatisation subies pour s'être opposées à la CMLO [para. 225], ce qui leur a causé des souffrances « psycho-émotionnelles » [para. 224] et, dans certains cas, les a contraintes à quitter La Oroya. Elle a également estimé que la pollution environnementale et l'inaction de l'État avaient causé des souffrances [para. 228] et contribué à la migration forcée de certaines victimes. Para. 230. La Cour a également souligné que les effets de la pollution « affectent de manière disproportionnée les individus, les groupes et les communautés qui souffrent déjà de la pauvreté, de la discrimination et de la marginalisation systémique ». Para. 231.
Droits des enfants
La Cour a souligné la protection spéciale à laquelle les enfants ont droit contre la pollution de l’environnement et l’émission de polluants qui contribuent au changement climatique [paragraphes 141 et 143], exigeant une plus grande diligence et une surveillance accrue de l’État lorsque leurs droits sont menacés. Paragraphe 142.
La Cour a noté que les preuves présentées « établissent que la santé et le développement d'un enfant peuvent être particulièrement affectés par l'exposition aux métaux lourds, notamment au plomb » [para. 236], ce qui nécessite des mesures de protection spéciales contre les impacts différenciés. Para. 242. Il est pertinent que la Cour ait considéré que depuis 1981, date à laquelle elle pouvait exercer sa compétence contentieuse concernant le Pérou, 57 des victimes étaient ou sont des enfants. Para. 238. De plus, le manquement de l'État à superviser et contrôler les activités du CMLO constituait une violation de l'obligation de protection spéciale concernant les droits des enfants à l'égard de ces victimes. Para. 242, 264.
Droit d'accès à l'information
La Cour a souligné que l'accès à l'information sur les activités ayant un impact potentiel sur l'environnement est d'un intérêt public évident et a souligné le devoir de transparence active de l'État. Paragraphes 145 à 147.
Français Dans le cas spécifique, il a été reconnu que l'État a pris des mesures pour informer la population sur la pollution [paras. 248–252], mais que celles-ci étaient « insuffisantes pour assurer un accès effectif à l'information » [para. 255] et, par conséquent, ont violé le droit à l'information, puisque des éléments adéquats n'ont pas été fournis pour faire connaître les risques pour la santé, l'intégrité personnelle et la vie. Para. 265.
Droit à la participation politique
En ce qui concerne la participation politique, la Cour a noté l’obligation de l’État de garantir la participation des individus relevant de sa juridiction « à la prise de décisions et aux politiques susceptibles d’affecter l’environnement […] ». Para. 152.
Bien que la Cour ait reconnu que l’État avait pris certaines mesures pour permettre la participation des citoyens aux questions environnementales [paras. 257–260, 265], elle a estimé qu’il n’était pas possible de déterminer si ces mesures offraient aux victimes des possibilités effectives « d’être entendues et de participer à la prise de décisions […] ». Para. 260. Par conséquent, elle a conclu que l’État avait violé le droit à la participation politique.
Droit à la protection judiciaire et devoir d'enquête
La Cour a souligné que les États ont l'obligation de garantir l'accès à la justice, y compris le droit à un recours effectif, à une procédure régulière et à réparation pour toute violation des droits de l'homme. Para. 273. De plus, la Cour a réaffirmé que « l'efficacité des arrêts dépend de leur exécution », qui doit être « complète, parfaite, intégrale et opportune ». Para. 274. Dans cette affaire, la Cour a jugé que l'État ne s'était pas conformé à certaines ordonnances rendues par la Cour constitutionnelle [para. 283] et que les mesures prises étaient inefficaces ou tardives. Para. 290, 297. Cela a conduit à une violation de l'obligation de garantir la protection judiciaire.
Français Concernant l'absence d'enquête, la Cour a souligné l'importance particulière de mener des enquêtes dans des contextes où des menaces pèsent sur les défenseurs des droits humains, y compris les défenseurs de l'environnement. Paragr. 303, 305. Dans l'affaire La Oroya, les actes de harcèlement contre certaines victimes se sont produits dans un contexte de conflit social, où leur opposition à la pollution environnementale était perçue par certains travailleurs de CMLO comme une menace pour leurs moyens de subsistance. Paragr. 307. La Cour a décrit les efforts de mobilisation et de dénonciation des victimes, ainsi que le harcèlement qu'elles ont subi. Paragr. 311-316. En fin de compte, la Cour a conclu que l'État n'avait pas mené d'enquête diligente sur les faits signalés. Paragr. 319.
Conclusions et réparations
Pour toutes ces raisons, la Cour a déclaré le Pérou responsable de la violation des droits à un environnement sain, à la santé, à la vie, à une vie digne, à l’intégrité personnelle, à l’accès à l’information et à la participation politique, à un recours judiciaire effectif, aux garanties judiciaires, à la protection judiciaire (devoir d’enquête), ainsi qu’aux droits des enfants (articles 26, 4.1, 5, 19, 13, 23, 25.2.c, 8.1, 1.1 et 2 de la Convention américaine).
Français Enfin, la Cour a ordonné à l'État de promouvoir des enquêtes concernant les actes de menaces et de harcèlement contre les victimes de l'affaire et la contamination environnementale à La Oroya [para. 142, point 12] ; de réaliser un diagnostic de base et un plan d'action pour réparer les dommages environnementaux. Para. 142, point 13. L'État a également été condamné à fournir « gratuitement et aussi longtemps que nécessaire » un traitement médical, psychologique et psychiatrique aux victimes [para. 142, point 14], et à mettre en place un système de soins médicaux spécialisés. Para. 142, point 18. Au-delà de l'indemnisation monétaire pour les dommages matériels et immatériels [para. 142, point 23], la Cour a également ordonné des mesures de satisfaction, telles qu'un acte public de reconnaissance de responsabilité internationale [para. 142, point 15], et des mesures de non-répétition, telles que l'harmonisation de la législation définissant les normes de qualité de l'air, la garantie de l'efficacité du système d'alerte et la formation des fonctionnaires judiciaires et administratifs. Para. 142, points 16, 17 et 20.
*Remarque : les traductions sont automatisées. Toutes les citations traduites doivent donc être vérifiées par rapport à la langue d'origine.*