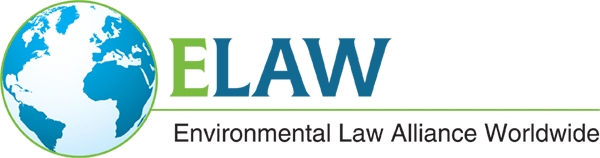Perturbation anthropique des écosystèmes de mangroves des Caraïbes : impacts passés, tendances actuelles et prévisions futures
Numéro d'étude :
58
Auteur:
AM Ellison et EJ Farnsworth
Abstrait:
Nous passons en revue les impacts historiques, actuels et futurs projetés de quatre classes de perturbations anthropiques : extraction, pollution, remise en état (aménagement côtier) et changement climatique sur les écosystèmes de mangroves des Caraïbes (mangal). Ces perturbations se produisent respectivement à des échelles spatiales et temporelles croissantes et nécessitent un temps de récupération croissant. L'extraction sélective à petite échelle a peu d'effet à l'échelle du système, mais la régénération est lente, même sur les coupes à blanc d'un seul hectare (la déforestation) en raison de l'acidification rapide des sols. Le pétrole est le principal polluant du mangal des Caraïbes et entraîne la défoliation des arbres, la mort des peuplements et la perte des espèces animales sessiles et mobiles associées. Les hydrocarbures persistent dans les sédiments des mangroves pendant des décennies et sont corrélés à des taux de mutation croissants des semis (extinction). Les déchets chimiques, industriels et urbains sont associés à une teneur accrue en métaux lourds des semis, au dépérissement des peuplements et à une réduction de la richesse spécifique à l'échelle du système (extinction), et une incidence plus élevée de Vibrio spp. (intoxication par les crustacés). Mangal a été récupéré pour l'urbanisation, l'industrialisation et, de plus en plus, pour le tourisme (développement côtier). Dans l’ensemble, la région perd des forêts de mangrove au rythme de 1 pour cent par an, bien que le taux soit beaucoup plus rapide sur le continent des Caraïbes (- 1,71 TP3T an-1) que sur les îles (= 0,21 TP3T an-1). Les pêcheries de la région déclinent à un rythme similaire, car la plupart des coquillages et poissons commerciaux utilisent le mangal pour leurs nourriceries et/ou refuges. Peu d’États des Caraïbes disposent d’une législation ou de capacités d’application pour protéger ou gérer le mangal, bien qu’au moins 11 traités et conventions internationaux pourraient être appliqués pour conserver ou utiliser durablement ces forêts. Ces traités peuvent protéger le mangal fluvial et de bassin, mais seront probablement sans objet en ce qui concerne le mangal marginal, qui pourrait disparaître en raison de la crise mondiale. changement climatique. L’amélioration de la croissance des mangroves résultant de l’augmentation du CO2 atmosphérique ne compensera probablement pas les effets négatifs de l’élévation concomitante du niveau de la mer au niveau régional.
Principaux résultats et conclusions :
- Trente-deux pays ont été étudiés pour déterminer la couverture de l'habitat des mangroves (voir tableau 1).
- Histoire naturelle et couverture des mangroves dans les Caraïbes :
- En 1990, il restait 13 501 km2 d’habitat de mangrove ; « Les données sur la longueur du littoral et la superficie des mangroves pour la Colombie, le Costa Rica, le Guatemala, le Honduras, le Nicaragua et le Panama » ne concernent que les longueurs et l'étendue des côtes des Caraïbes… Données de Groombridge (1992), Lugo & Bayle (1992), Alvarez-Leon ( 1993), Bacon (1993c), D'Croz (1993), Polanfa (1993), Garrity et coll. (1994) et Giglioli (1994). NA : données non disponibles » (Tableau 1, 551).
- « Sur la base des données présentées dans le tableau 1, la superficie globale du mangal dans les Caraïbes a diminué de -10 pour cent au cours des années 1980. La superficie du Mangal a diminué de -17 pour cent sur le continent, mais de seulement -2 pour cent sur les îles »(552).
- Perturbations anthropiques :
- Extraction – toute forme d’extraction modérée/durable des ressources de mangrove n’entraîne pas de conséquences dévastatrices. Extraction à grande échelle de la forêt de mangrove (la déforestation), cependant, entraîne « une accumulation rapide de sulfures dans le sol et une acidification ultérieure du sol (Hamilton & Snedaker 1984) ». En outre, les rendements de la pêche peuvent être affectés par l'extraction des forêts de mangroves, car elle entraîne une perte d'habitat pour les poissons juvéniles (553).
- Pollution-
- « La pollution pétrolière [pétrolière] résultant de l'exploration et de la production pétrolières en mer, des pipelines, des accidents de pétroliers et du nettoyage intentionnel des réservoirs de ballast des navires affecte le mangal dans toutes les Caraïbes (revues dans Rodriguez 1981, Burns et coll. 1993, UICN 1993a) » (553). Des dizaines de marées noires se sont produites dans les Caraïbes depuis les années 1980 et, dans certains cas, comme celle de Galteta, au Panama, provoquant une « défoliation massive des arbres, suivie par la mort des semis, des jeunes arbres et des arbres… » (Garrity et al., 1994) »(553). La réhabilitation des mangroves après des marées noires est pratiquement inexistante en raison de la difficulté de cultiver des mangroves dans les zones polluées par les hydrocarbures.
- La pollution thermique provenant des systèmes de refroidissement des centrales électriques a également un impact négatif sur les mangroves (554).
- Les autres polluants identifiés dans le document (cités dans d'autres études) comprennent : le mercure, les résidus et composés miniers, les eaux usées, le ruissellement urbain, la contamination par les pesticides, le N2O et la sédimentation des sources urbaines. développement (côtier) (554-555).
- Réhabilitation – cela implique la transformation de l’habitat des mangroves en espaces de développement urbain (développement côtier). Des projets massifs de remise en état ont été mis en œuvre dans de nombreux pays des Caraïbes, notamment en Colombie et au Venezuela (555). Le tourisme a également joué un rôle dans des projets massifs de réhabilitation (conversion des forêts de mangroves en centres de villégiature, terrains de golf, etc.) (555).
- Changement climatique – alors que l’élévation du niveau de la mer peut affecter négativement certains habitats de mangroves où le recul est impossible en raison d’obstacles anthropiques ou d’une mauvaise composition du sol, l’augmentation des niveaux de CO2 peut contribuer à aggraver ces effets négatifs, mais seulement légèrement (557-558). Des températures atmosphériques plus élevées peuvent également avoir un impact négatif sur les forêts de mangroves (557).
- La conservation des mangroves varie selon les pays des Caraïbes (558). Jusqu'à 11 traités internationaux pourraient être utilisés pour protéger les mangroves dans les Caraïbes et jusqu'à six pourraient être utilisés pour l'usage autochtone et/ou l'écotourisme (sensible) (560). Le tableau 3 répertorie plusieurs traités qui ont ou n'ont pas été ratifiés par des pays à l'intérieur et à l'extérieur des Caraïbes (559).
Ouvrages cités:
Alvarez-LEON, R. 1993. Écosystèmes de mangroves de Colombie. Dans LD Lacerda (éd.). Conservation et utilisation durable des forêts de mangroves dans les régions d'Amérique latine et d'Afrique. Partie I-Amérique latine, pp. 75-114. Société internationale pour les écosystèmes de mangroves, Okinawa.
Bacon, PR 1975. Récupération d'une mangrove trinidadienne suite à une tentative de remise en état. Dans GE Walsh, SC Snedaker et HJ Teas (Eds.). Actes du colloque international sur la biologie et la gestion des mangroves, pp. 805-815. Institut des Sciences de l'Alimentation et de l'Agriculture, Univ. de Floride, Gainesville.
Burns, KA, SD Garrity et SC Levings. 1993. Combien d’années faudra-t-il avant que les écosystèmes de mangroves ne se remettent des marées noires catastrophiques ? Sondage de mars. Taureau. 26(5) : 239-248.
D'Croz, L. 1993. Statut et utilisations des mangroves dans la République du Panama. Dans LD Lacerda (éd.). Conservation et utilisation durable des forêts de mangroves dans les régions d'Amérique latine et d'Afrique. Partie I-Amérique latine, pp. 115-128. Société internationale pour les écosystèmes de mangroves, Okinawa.
Garrity, SD, SC Levings et KA Burns. 1994. La marée noire de Galeta. I. Effets à long terme sur la structure physique de la frange de mangrove. Est., Côte. Étagère Sci. 38 : 327-348.
Giglioli, MEC 1994. Les années de boom à Grand Cayman : détérioration et conservation de l'environnement. Dans MA Brunt et JE Davies (Eds.). Les îles Caïmans : histoire naturelle et biogéographie, pp. 509-526. Éditeurs académiques Kluwer, Dordrecht.