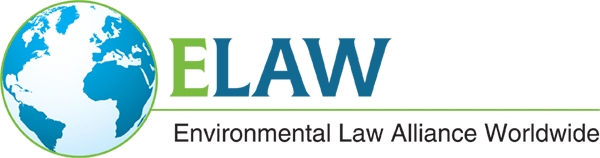Les mangroves du monde
Numéro d'étude :
48
Auteur:
Organisation des États-Unis pour l'alimentation et l'agriculture
Abstrait:
La forte pression démographique dans les zones côtières a conduit à la conversion de nombreuses zones de mangrove à d'autres usages et de nombreuses études de cas décrivent ces pertes de mangroves au fil du temps. Néanmoins, les informations sur l’état actuel et les tendances de l’étendue des mangroves au niveau mondial sont rares. Avec la préparation du présent rapport, la FAO vise à faciliter l'accès à des informations complètes sur l'étendue actuelle et passée des mangroves dans tous les pays et zones où elles existent. Les informations fournies dans ce rapport, ainsi que les lacunes d'informations qu'il met en évidence, serviront d'outils aux gestionnaires de mangroves et aux décideurs politiques du monde entier….
Quelque 2 900 ensembles de données nationales et infranationales sur l’étendue des écosystèmes de mangroves ont été collectés au cours de ce processus, permettant la compilation d’une liste mise à jour de l’estimation fiable la plus récente pour chacun des 124 pays et zones dans lesquels des mangroves sont connues. Des analyses de régression basées sur des données historiques ont fourni des estimations révisées pour 1980, 1990, 2000 et une prévision pour 2005 pour chaque pays. Les changements apportés aux définitions et aux méthodologies au fil du temps rendent difficile la comparaison des résultats de différentes évaluations, et l'extrapolation jusqu'en 2005 a été limitée par le manque d'informations récentes pour un certain nombre de pays. Cette estimation est donc indicative et est susceptible de changer lorsque les résultats des évaluations en cours et futures seront disponibles.
Les résultats obtenus indiquent que la superficie mondiale des mangroves s'élève actuellement à environ 15,2 millions d'hectares, les plus grandes superficies se trouvant en Asie et en Afrique, suivies par l'Amérique du Nord et l'Amérique centrale. Un nombre alarmant de 20 pour cent, soit 3,6 millions d'hectares de mangroves, ont été perdus depuis 1980. Plus récemment, le taux de perte nette semble avoir ralenti, même s'il reste encore inquiétant. Environ 185 000 ha ont été perdus chaque année dans les années 80 ; ce chiffre est tombé à environ 118 500 ha par an dans les années 1990 et à 102 000 ha par an (–0,66 pour cent) au cours de la période 2000-2005, reflétant une prise de conscience accrue de la valeur des écosystèmes de mangrove.
Même si les mangroves sont souvent utilisées pour la collecte de produits forestiers ligneux et comme source de subsistance pour les populations locales, l’élimination des produits forestiers ligneux et non ligneux est rarement la principale cause de la perte des mangroves. Pression humaine sur les écosystèmes côtiers et compétition pour les terres pisciculture, agriculture, infrastructures et tourisme (développement côtier) sont souvent élevées et sont les principales causes de la diminution des superficies signalées. Les taux de changement négatifs relativement importants qui se sont produits en Asie, dans les Caraïbes et en Amérique latine au cours des années 1980 ont été causés principalement par la conversion à grande échelle des zones de mangrove en pisciculture et les infrastructures touristiques…
Principaux résultats et conclusions :
- Biens et services écosystémiques fournis par les mangroves (5) :
- Combustible : bois de chauffage, charbon de bois
- Construction : bois d'œuvre, échafaudages, construction lourde, traverses de chemin de fer, étais miniers, construction de bateaux, pilotis de quai, poutres et poteaux, revêtements de sol, lambris, chaume ou nattes, poteaux de clôture, panneaux de particules.
- Pêche : piquets de pêche, bateaux de pêche, bois pour fumer le poisson, tanins pour filets/lignes, abris attirant les poissons
- Textile : cuir, fibres synthétiques (rayonne), teinture pour tissu, tanin pour la préservation du cuir
- Autres produits naturels : poissons, crustacés, miel, cire, oiseaux, mammifères, reptiles, autre faune
- Aliments, drogues et boissons : sucre, alcool, huile de cuisson, vinaigre, substitut de thé, boissons fermentées, garnitures pour desserts, condiments (écorces), friandises (propagules), légumes (fruits/feuilles)
- Agriculture: fourrage [foin séché/aliment pour bétail]
- Articles ménagers : colle, huile de coiffure, manches d'outils, mortier de riz, jouets, allumettes, encens
- Autres produits forestiers : caisses d'emballage, bois pour fumer des feuilles de caoutchouc, médicaments
- Produits en papier : papier – divers
- Les pays/zones du monde entier sont présentés sous forme de tableau avec la couverture de mangrove associée (ha) et l'année (Tableau 3, 10-11).
- L'Indonésie possède la plus grande superficie de mangrove (19%), suivie de l'Australie (10%) et du Brésil et du Nigeria (chacun avec 7%). D’autres pays sont répertoriés dans la figure 3, page 12.
- L’Asie a connu la plus grande transformation des forêts de mangroves (Fig. 4, 12).
- Voir le document pour des régions spécifiques concernant la végétation et la composition des espèces, les ressources de mangrove : état et tendances 1980-2005, principales utilisations et menaces, et conservation et gestion des mangroves.
- Conclusions :
- « …la superficie mondiale actuelle des mangroves est tombée à environ 15,2 millions d’hectares, contre 18,8 millions d’hectares en 1980. Le monde a ainsi perdu quelque 3,6 millions d’hectares de mangroves au cours des 25 dernières années, soit 20 pour cent de l’étendue trouvée en 1980. » (55).
- « D’environ 185 000 ha perdus chaque année dans les années 1980, la perte nette est tombée à environ 118 500 ha par an dans les années 1990 et à 102 000 ha par an (soit une perte de 0,66 pour cent par an) au cours de la période 2000-2005. reflétant une prise de conscience accrue de la valeur des écosystèmes de mangrove » (55).
- « Pression humaine sur les écosystèmes côtiers et donc compétition pour les terres pisciculture, agriculture, infrastructures et tourisme (développement côtier) sont souvent intenses et comptent parmi les principales causes de la diminution signalée de ces superficies forestières au fil du temps » (55).