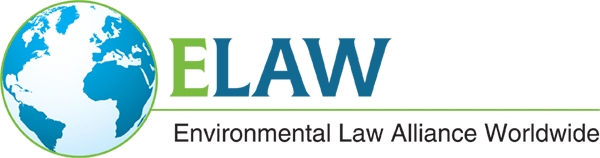Belize — BACONGO c. Ministère de l'Environnement et Belize Electric Company Limited (Jugement relatif à une requête en ordonnance conservatoire des Lords du Comité judiciaire du Conseil privé (13 août 2003) (Chalillo) (1 sur 2 décisions)
Appel du Conseil privé n° 47 de 2003
L'Alliance bélizienne pour la conservation, organisation non gouvernementale
Organisations appelantes
v.
(1) Le ministère de l’Environnement et
(2) Belize Electricity Company Limited Intimés
DEPUIS
LA COUR D'APPEL DU BELIZE
—————
JUGEMENT SUR UNE REQUÊTE POUR UNE
ORDRE CONSERVATOIRE DES SEIGNEURS DE LA
COMITÉ JUDICIAIRE DU CONSEIL PRIVÉ,
Livré le 13 août 2003
——————
Présent à l'audience : -
Seigneur Walker de Gestingthorpe
Sir Martin Nourse
Sir Andrew Leggatt
[Livré par Lord Walker de Gestingthorpe]
——————
Intérêts publics concurrents au Belize : le projet MRUSF
1. Le Belize est bordé au nord par la province mexicaine du Yucatan, à l’est par la mer et au sud et à l’ouest par le Guatemala. Au centre du pays se trouvent les montagnes Maya. Leurs versants nord-ouest donnent sur les vallées des rivières Macal et Raspaculo, en partie dans le parc national de Chiquibul. Une grande partie de cette zone est constituée de forêt tropicale pratiquement épargnée par l’impact de l’activité humaine depuis l’époque des Mayas, il y a environ 500 ans. La région est riche en faune et flore rares ; les mammifères (diversement classés comme vulnérables, menacés ou en voie de disparition) comprennent les jaguars, les ocelots, les pumas et les tapirs ; il existe également une forme rare de crocodile ; les oiseaux comprennent des aras écarlates. La zone contient également un certain nombre de sites mayas d'un grand intérêt archéologique.
2. Le Belize n'est pas un pays riche. Le tourisme (et en particulier ce qu'on appelle parfois l'écotourisme) est important pour son économie, de sorte que le Belize a un intérêt économique (et culturel) dans la préservation de ces ressources naturelles précieuses et fragiles. Cependant, le Belize a un problème énergétique. Une partie de son approvisionnement en électricité est importée du Mexique. Les consommateurs nationaux paient des tarifs d’électricité exceptionnellement élevés. La demande d’électricité augmente. Des coupures de courant surviennent de temps en temps. Il existe donc un intérêt public à augmenter la capacité de production hydroélectrique du pays, et le projet Macal River Upstream Storage Facility (« MRUSF ») vise à y parvenir par la construction d'un barrage et d'ouvrages associés à Chalillo, en amont du village de Cristo Rey. et la ville de San Ignacio.
3. Il existe déjà une centrale hydroélectrique (construite en 1994) à Mollejon, en aval de Chalillo. Mollejon est une centrale électrique au fil de l'eau – c'est-à-dire qu'aucune eau n'est retenue – et son fonctionnement efficace dépend d'un débit suffisant dans la rivière Macal. Le débit est cependant peu fiable pendant la saison sèche (mi-février à mi-juin). Le nouveau projet aurait un double objectif : produire de l'électricité dans une nouvelle centrale électrique au barrage de Chalillo et (en retenant l'eau derrière le barrage) assurer un écoulement régulier de l'eau, à tout moment de l'année, vers le Mollejon. centrale électrique.
4. Le barrage de Chalillo sera construit en béton compact à rouleaux, d'une hauteur de 49 mètres. Une fois pleine, elle couvrira une superficie d'environ 9,5 kilomètres carrés mais (en raison du terrain) la zone retenue aura une forme très irrégulière, s'étendant sur environ 20 kilomètres en amont de la rivière Macal et environ 10 kilomètres en amont de la rivière Raspaculo. Il y aura une centrale électrique de 7,3 MW au pied du barrage et une ligne de transport d'électricité (diversement indiquée comme longue de 13 ou 18 kilomètres) de la centrale à Mollejon. Le plan initial (décidé après les premières études de faisabilité entreprises en 1992) prévoyait que les travaux sur les routes d'accès et autres travaux préliminaires débuteraient en mars 2002 ; pour que la retenue de l'eau commence en juin 2003 ; et pour la mise en service des turbines-alternateurs de la centrale début 2004. Ce programme a cependant été reporté d'environ un an, comme expliqué ci-dessous.
5. Le projet MRUSF a suscité une controverse tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du Belize. Au Belize, l'opposition au projet a été menée par l'Alliance bélizienne des organisations non gouvernementales de conservation (« BACONGO »), le pétitionnaire auprès du Conseil. Il s'agit d'une organisation faîtière regroupant neuf organismes environnementaux et similaires distincts établis au Belize. Elle a été constituée en 1994 selon les lois du Belize. Elle avait autrefois un bureau au Belize, mais elle opère désormais à partir des bureaux d'un ou plusieurs de ses organes constituants. Il a été suggéré par les personnes interrogées qu'il est financé en grande partie par des sources extérieures au Belize.
6. Le premier défendeur est le Département de l'environnement (« le DoE »), un département du gouvernement du Belize. Le deuxième défendeur est Belize Electricity Company Limited (« BECOL »), la société qui souhaite réaliser le projet MRUSF par l'intermédiaire de son maître d'œuvre, une société chinoise. BECOL est une filiale 95% de Fortis Inc. (« Fortis »), une société canadienne. Fortis détient également 68% de Belize Electricity Limited (« BEL »), qui possède et exploite le système de distribution d'électricité au Belize.
Protection de l'environnement au Belize
7. Le Belize dispose de lois sur la protection de l'environnement qui, notamment en ce qui concerne l'évaluation de l'impact sur l'environnement (« EIE »), ne sont pas totalement différentes de celles en vigueur au Royaume-Uni (et même dans l'ensemble de l'Union européenne). Aux fins actuelles, la législation primaire et secondaire la plus importante est la Loi sur la protection de l'environnement, adoptée en 1992 et modifiée depuis (« la Loi ») et le Règlement sur l'évaluation de l'impact environnemental de 1995 (« le Règlement »).
8. La partie II de la loi crée le DoE et définit ses fonctions. La partie V (articles 20 à 23) traite de l'exigence d'une EIE. L'article 20 (à l'exception du paragraphe (8) qui n'est pas important) est rédigé dans les termes suivants :
« (1) Toute personne ayant l’intention d’entreprendre un projet, un programme ou une activité susceptible d’affecter de manière significative l’environnement doit faire réaliser une évaluation de l’impact environnemental par une personne dûment qualifiée et doit la soumettre au Département pour évaluation et recommandations.
(2) Une évaluation de l’impact environnemental doit identifier et évaluer les effets de développements spécifiés sur :
(a) les êtres humains ;
(b) la flore et la faune ;
(c) le sol ;
d) de l'eau;
e) facteurs atmosphériques et climatiques;
(f) les biens matériels, y compris le patrimoine culturel et le paysage ;
(g) ressources naturelles;
h) l'équilibre écologique;
(i) tout autre facteur environnemental devant être pris en compte.
(3) Une évaluation d'impact environnemental doit inclure les mesures qu'un promoteur proposé a l'intention de prendre pour atténuer tout effet environnemental négatif et une déclaration des sites alternatifs raisonnables (le cas échéant) et des raisons de leur rejet.
(4) Tout projet, programme ou activité doit être évalué en tenant compte de la nécessité de protéger et d'améliorer la santé humaine et les conditions de vie et de la nécessité de préserver la capacité de reproduction des écosystèmes ainsi que la diversité des espèces.
(5) Lorsqu’il réalise une évaluation d’impact environnemental, le promoteur proposé doit consulter le public et les autres organismes ou organisations intéressés.
(6) Le Département peut réaliser sa propre évaluation des impacts environnementaux et synthétiser les opinions du public et des organismes intéressés.
(7) Une décision du ministère d’approuver une évaluation d’impact environnemental peut être soumise à des conditions raisonnablement requises à des fins environnementales.
L'article 21 prévoit la prise de règlements. L'article 22 prévoit des sanctions pénales en cas de non-exécution d'une EIE requise par la loi.
9. Les articles 4 et 5 du Règlement sont rédigés dans les termes suivants :
« 4. (1) Lors de l'identification du processus d'évaluation de l'impact environnemental en vertu du présent règlement, les questions environnementales importantes pertinentes doivent être identifiées et examinées avant de commencer et d'entreprendre un tel projet ou activité.
(2) Le cas échéant, tous les efforts doivent être déployés pour identifier tous les problèmes environnementaux à un stade précoce du processus d'évaluation de l'impact sur l'environnement.
5. Une évaluation des incidences sur l'environnement comprend au moins les exigences minimales suivantes :
a) une description des activités proposées;
(b) une description de l'environnement potentiellement affecté, y compris les informations spécifiques nécessaires pour identifier et évaluer l'effet environnemental des activités proposées ;
(c) une description des alternatives pratiques, le cas échéant ;
(d) une évaluation des impacts environnementaux probables ou potentiels des activités proposées et des solutions de rechange, y compris les effets directs et indirects, cumulatifs, à court terme et à long terme ;
(e) une identification et une description des mesures disponibles pour atténuer les impacts environnementaux négatifs de l'activité ou des activités proposées et une évaluation de ces mesures d'atténuation ;
(f) une indication des lacunes dans les connaissances et des incertitudes qui peuvent être rencontrées lors du calcul des informations requises.
Le Règlement 7 et l'Annexe I rendent une EIE obligatoire pour certaines catégories de projets, y compris les barrages. En vertu des réglementations 11 et 14 à 17, le DoE doit être informé lorsqu’une EIE est ou peut être requise. Le projet de termes de référence doit être soumis et approuvé par le DoE. Le règlement 18 prévoit une consultation publique lors de la préparation d’une EIE.
10. La règle 19 prescrit de manière très détaillée ce qui doit être inclus dans une EIE. M. Clayton QC (pour BACONGO) a particulièrement attiré l'attention sur les exigences suivantes :
«(e) Une description du développement proposé, comprenant des informations sur le site, la conception, la taille et l'échelle du développement, et ses environs immédiats ;
f) Une description de l'environnement (local et régional);
(g) Impacts environnementaux importants. Les données nécessaires pour identifier et évaluer les principaux effets que le développement proposé est susceptible d'avoir sur l'environnement ;
(h) Une description des effets importants probables, directs et indirects, du développement sur l'environnement, expliqués par référence à son impact possible sur :
êtres humains;
flore;
faune;
sol;
eau;
air;
climat;
les biens matériels, y compris le patrimoine culturel et le paysage ;
ressources naturelles;
l'équilibre écologique; et
tout autre facteur environnemental qui doit être pris en compte ;
…
(j) Les conséquences environnementales du projet tel que proposé et les alternatives, identifiant les effets négatifs qui ne peuvent être évités si l'action est mise en œuvre, toutes les mesures d'atténuation à utiliser pour réduire les effets négatifs, la relation entre les utilisations à court terme de l'environnement et l'amélioration de la productivité à long terme et tout engagement irrémédiable ou irréversible de ressources qui se produirait si l'action était mise en œuvre comme proposé ;
(k) Un plan d'atténuation ;
l) Un plan de surveillance ;
…
(n) Rapport sur les audiences publiques (le cas échéant).
(o) Un résumé en termes non techniques de la langue spécifiée ci-dessus.
11. La réglementation 20 prévoit que toute EIE soumise au DoE soit rendue publique et que des objections et des représentations soient faites auprès du DoE. Le Règlement 21 exige que le DoE, dès réception d’une EIA,
« Examinez-le ou faites-le examiner pour déterminer si
(i) une évaluation environnementale plus approfondie est nécessaire ; ou
(ii) tout impact nocif significatif est indiqué.
Les règlements 22, 23 et 24 sont les suivants :
« 22.(1) Le Ministère avise le promoteur de sa décision dans les soixante jours suivant la réception par le Ministère de l'évaluation d'impact environnemental complétée.
(2) Jusqu'à ce que le promoteur soit informé en vertu du sous-règlement (1), le promoteur ne doit pas commencer ni poursuivre l'entreprise.
(3) Lorsqu'un promoteur est tenu de fournir des informations complémentaires ou supplémentaires concernant l'évaluation de l'impact environnemental, l'évaluation de l'impact environnemental n'est pas réputée avoir été achevée tant que le promoteur n'a pas fourni ces informations complémentaires ou complémentaires à la satisfaction du Ministère.
23. Lorsque l'évaluation de l'impact environnemental présente des lacunes à quelque égard que ce soit, le ministère peut, sur recommandation du Comité national d'évaluation environnementale, exiger du promoteur :
(a) mener des travaux ou des études supplémentaires ;
(b) fournir des informations complémentaires;
c) modifier l'évaluation des incidences sur l'environnement en conséquence; et
d) soumettre à nouveau l'évaluation des incidences sur l'environnement à une date ultérieure mutuellement acceptable.
24.(1) Le Ministère, sur recommandation du Comité national d'évaluation environnementale, peut exiger la tenue d'une audience publique à l'égard de toute entreprise, projet ou activité à l'égard duquel une évaluation des impacts environnementaux est requise en vertu du présent règlement.
(2) Afin de déterminer si une entreprise, un projet ou une activité nécessite une audience publique, le Ministère tient compte des facteurs suivants :
(a) l'ampleur et le type de l'impact environnemental, le montant de l'investissement, la nature de la zone géographique et l'engagement des ressources naturelles impliquées dans l'entreprise, le projet ou l'activité proposé ;
b) le degré d'intérêt du public, du Ministère et d'autres organismes gouvernementaux à l'égard de l'entreprise, du projet ou de l'activité proposé, comme en témoigne la participation du public à l'entreprise, au projet ou à l'activité proposé ;
c) la complexité du problème et la possibilité que les informations présentées lors d’une audience publique puissent aider le promoteur à s’acquitter de ses responsabilités concernant l’entreprise, le projet ou l’activité proposé.
12. L'article 25 du Règlement prévoit la nomination d'un Comité national d'évaluation environnementale (« NEAC »). Ses fonctions sont de :
« a) examiner toutes les évaluations d’impact environnemental ;
b) informer le Ministère du caractère adéquat ou non de l'évaluation des impacts environnementaux;
(c) informer le ministère des circonstances dans lesquelles une audience publique est souhaitable ou nécessaire.
Le NEAC est composé de douze membres avec un quorum de six. Le président est le Directeur de l'Environnement (actuellement M. Ismael Fabro). Neuf autres membres sont des fonctionnaires et deux sont des représentants non gouvernementaux. L'une des représentantes non gouvernementales est Mme Candy Gonzalez, une partisane active de BACONGO. Le règlement 26 définit les facteurs que le NEAC doit prendre en compte dans son travail.
Les décisions attaquées et la procédure ci-dessous.
13. En août 1999, une EIE préparée au nom de BECOL a été soumise au DoE et transmise au NEAC pour examen. Il avait été préparé pour BECOL par AMEC E & C Services Ltd, une société canadienne de consultants. L'EIE n'a pas été présentée à l'Office (même sous la forme d'un résumé), mais elle a été portée devant les tribunaux inférieurs. Il s'agit d'un document volumineux, composé d'un grand volume principal et de quatre grands volumes de support s'étendant sur environ 1 500 pages au total. Néanmoins, BACONGO l'a critiqué comme étant incomplet et déficient au point de ne pas être en mesure de satisfaire aux exigences de la loi et du règlement. C'est l'un des deux motifs invoqués par BACONGO dans la présente procédure. L'autre motif invoqué était l'incapacité du DoE à ordonner une audience publique en vertu du règlement 24.
14. Le 9 novembre 2001 (après les réunions des 4 octobre et 8 novembre ainsi que ce jour-là), le NEAC a voté (par 11 voix contre une, Mme Gonzalez étant minoritaire) pour recommander au DoE d'approuver l'EIE, et (à l'unanimité) qu'une audience publique soit tenue. Le 21 novembre 2001, BECOL, BEL et le gouvernement du Belize ont conclu un accord écrit appelé troisième accord-cadre. Il contenait dans les clauses 6 et 7 des dispositions inhabituelles par lesquelles le gouvernement accordait à BEL et BECOL de larges garanties et indemnisations concernant le projet MRUSF (appelé le nouveau projet). En janvier 2002, les travaux ont commencé sur les routes d'accès au site du barrage proposé.
15. Le 8 février 2002, BACONGO (et certains requérants individuels) demandèrent l'autorisation de demander un contrôle judiciaire de la décision prise par le NEAC le 9 novembre 2001. L'autorisation fut accordée le 28 février 2002. Les autres requérants avaient été joints au cas où la qualité pour agir de BACONGO devait être contestée, mais elle n'a pas été contestée et les autres requérants ont été autorisés à se retirer. La décision du NEAC a été décrite comme une approbation de l'EIE (plutôt que comme une recommandation au DoE pour son approbation). Cette erreur a été quelque peu encouragée par une déclaration sous serment datée du 28 février 2002 du responsable de l'environnement, M. Fabro, qui faisait référence à l'EIE comme ayant été approuvée. En fait, elle a été approuvée par le DoE le 5 avril 2002 mais (malgré la procédure de contrôle judiciaire en cours) BACONGO n'en a pas été informée. La réticence des défendeurs à divulguer des informations à BACONGO (même lorsqu'elles sont très importantes et pas manifestement confidentielles) a été un aspect regrettable de cette affaire. Il ne fait aucun doute que les intimés considèrent BACONGO comme une épine dans leur chair, mais leur attitude inutile ne peut qu'avoir eu tendance à accroître les soupçons de BACONGO, et peut-être aussi sa détermination à poursuivre le procès.
16. La décision du DoE a été annoncée dans une lettre datée du 5 avril 2002 de M. Fabro à M. Young, un directeur de BELCO qui a été étroitement concerné par le projet MRUSF. La lettre était la suivante :
Veuillez noter qu'une autorisation environnementale est accordée par la présente à Belize Electric Company Limited pour un projet hydroélectrique (installation de stockage en amont de Macal River). Cette autorisation environnementale est accordée suite à la signature du plan de conformité environnementale (ECP) préparé par le ministère de l'Environnement (DOE) le 5 avril 2002.
Veuillez noter que Belize Electric Company Limited est tenue de se conformer à tous les termes et conditions incorporés dans le plan de conformité environnementale. Le non-respect de l'un des termes et conditions stipulés dans le plan de conformité entraînera la révocation de l'autorisation environnementale et/ou des poursuites judiciaires contre Belize Electric Company Limited.
Aucun changement ou altération de ce qui a été convenu dans le DCE ne sera autorisé sans l'autorisation écrite du ministère de l'Environnement.
Merci pour votre aimable considération et votre coopération dans la résolution de ces questions d’intérêt commun.
17. L'audience de contrôle judiciaire a débuté le 18 juin 2002 devant le juge en chef Conteh. L'avocat du DoE a déclaré au juge en chef (ce qui était le plus surprenant) que l'autorisation environnementale n'avait pas encore été accordée, mais BECOL a ensuite produit la lettre de M. Fabro du 5 avril 2002. BACONGO a été autorisée à modifier sa demande pour contester également cette décision. L'audience de contrôle judiciaire s'est terminée le 31 juillet 2002. Le juge en chef a rendu son jugement le 19 décembre 2002. Il a reconnu BACONGO comme ayant agi avec un esprit civique louable. Il a toutefois rejeté l'attaque contre l'EIA. Il a ordonné au DoE de tenir une audience publique en vertu du règlement 24, mais n'a annulé ni la décision du NEAC du 9 novembre 2001 ni celle du DoE du 5 avril 2002. Il a conclu son jugement en citant un article du professeur Alder (JEL Vol 5). N° 2 (1993) 203, 211) :
« L’évaluation de l’impact environnemental n’est pas en tant que telle une mesure de protection de l’environnement ayant des objectifs positifs. L’évaluation de l’impact environnemental vise à permettre aux décideurs de faire un choix éclairé entre les objectifs environnementaux et autres et à consulter le public.
Le juge en chef a ajouté :
« Le rôle des tribunaux, bien entendu, n’est pas de faire ce choix éclairé et crucial, qui incombe aux décideurs politiques. Mais les tribunaux peuvent insister et veiller à ce que les règles applicables soient respectées, notamment en consultant le public lorsque l’affaire le justifie clairement.
Le Juge en chef n'a rendu aucune ordonnance concernant les dépens.
18. BACONGO a interjeté appel devant la Cour d'Appel. Pendant que l'appel était en instance, une audience publique a eu lieu conformément aux instructions du juge en chef. Le Conseil a été informé qu'au moins 50 personnes ont assisté à l'audience publique et qu'elle a été signalée et prise en compte par le DoE (M. Fitzgerald QC pour le DoE a initialement mentionné une participation d'environ 50 personnes, mais a ensuite corrigé ce chiffre à environ 500 ; M. Clayton pensait que le chiffre initial était correct, le Conseil ne peut pas résoudre cette différence). BACONGO a également demandé une injonction interdisant les travaux sur le barrage pendant que l'appel était pendant. C'était après que BACONGO ait demandé à BECOL de s'engager à ne pas commencer les travaux, et que BECOL ait refusé de prendre un engagement. La demande d'injonction n'a jamais été entendue par la Cour d'appel, ayant été ajournée par un juge unique de la Cour d'appel le 30 janvier 2003 pour être entendue par l'ensemble du tribunal. Mais BECOL n'a en réalité pas procédé aux travaux alors que l'appel était pendant.
19. La cour d’appel n’examina pas la demande d’injonction mais passa immédiatement à l’audience au fond, qui eut lieu entre le 24 et le 28 mars 2003. Le 31 mars 2003, la cour d’appel rejeta l’appel, avec les motifs suivants : suivre. Encore une fois, aucune ordonnance n’a été rendue quant aux dépens. Le 10 avril 2003, la Cour d'appel a accordé à BACONGO une autorisation conditionnelle de faire appel, l'ordonnance indiquant que la cour avait estimé que les questions soulevées dans l'appel étaient d'importance publique. L'autorisation définitive de faire appel a été accordée le 20 juin 2003.
20. Entre-temps, un certain nombre d'événements se sont produits. À une date non précisée après le rejet de l'appel, BECOL a conclu un contrat avec son entrepreneur principal. Le coût total du projet est estimé à environ 1,4 million de dollars américains. Le 22 mai 2003, BACONGO a demandé à BECOL des informations sur son projet de calendrier de construction, mais n'a jamais reçu de réponse. Le 28 mai 2003, BECOL a organisé une cérémonie d'inauguration des travaux en présence de hauts représentants de Fortis, la société holding canadienne. Le 30 mai 2003, BACONGO a demandé au DoE des informations sur le calendrier de construction. La réponse renvoyait BACONGO au PCE, qui ne contenait aucune information pertinente.
21. Les 13 et 16 juin 2003, le projet de loi sur le développement hydroélectrique de la rivière Macal fut adopté, dans chaque cas en une seule journée, respectivement par la Chambre des Représentants et le Sénat. Cette législation (« la Loi de 2003 ») soulève d'importantes questions constitutionnelles, comme indiqué ci-dessous. Le 17 juin, la cour d'appel a motivé son rejet. Les membres de la Cour (le P. Rowe, les juges Mottley et le juge Carey) ont été unanimes, même si leurs motifs variaient quelque peu. Les juges Rowe P et Carey ont statué qu'une audience publique n'était pas obligatoire (mais que si elle avait été exigée, elle aurait dû être tenue avant qu'une décision ne soit prise). Le juge Motley a statué qu'une audience publique était nécessaire. Ils étaient également divisés sur la question de savoir si une EIE conforme au Règlement était une condition nécessaire à l'approbation du projet. Ils ont tous convenu qu'il était approprié d'examiner les affidavits déposés par les membres du NEAC. La loi de 2003 est entrée en vigueur le 18 juin 2002, date fixée pour l'audition par la Cour d'appel de la demande d'injonction de BACONGO en attendant l'appel devant la Commission. Le 20 juin, la Cour d'appel a estimé (pour des motifs non liés à la loi de 2003) qu'elle n'était pas compétente pour accorder une injonction. Le 23 juillet, BACONGO a présenté la requête en mesures provisoires qui est maintenant devant le Conseil. Son appel au Conseil privé fut enregistré le même jour.
La loi de 2003
22. Le titre long de la loi de 2003 est :
« Loi visant à faciliter et à garantir que les projets hydroélectriques sur la rivière Macal soient mis en œuvre d'une manière respectueuse de l'environnement, sans retard injustifié, afin de garantir un approvisionnement fiable en énergie électrique, à un coût raisonnable pour le développement efficace et continu de l'économie bélizienne et le bien-être de la population du Belize et augmenter la production d’électricité au Belize.
Il contient un préambule allant dans le même sens. L’article 3(2) contient un certain nombre de déclarations et d’affirmations qui, aux termes de l’article 3(1), doivent être « interprétées et interprétées généreusement, selon leur esprit et leur intention afin de donner véritablement effet à la présente loi ».
23. L'article 4 est rédigé dans les termes suivants :
« Conformément à l'article 3, et nonobstant toute autre loi contraire :
(a) BECOL et BEL sont par les présentes ordonnées et autorisées à procéder à la conception, au financement, à la construction et à l'exploitation du projet Chalillo conformément à la Loi, au Troisième Accord-cadre et à l'ECP ;
(b) Mais sous réserve de l'article 6 des présentes, le respect par BECOL et BEL du DCE constituera le respect de toutes les lois environnementales auxquelles le projet Chalillo, ou sa conception, son financement, sa construction ou son exploitation, peut être soumis, y compris, sans s'y limiter, le respect avec l'EPA, et aucun autre examen, audience, évaluation, approbation ou autre procédure en vertu d'une autre loi ne sera requis pour autoriser ou permettre la conception, le financement, la construction et l'exploitation du projet Chalillo conformément au paragraphe (a) ;
(c) Mais sous réserve de l'article 6 des présentes, le respect par BECOL et BEL des conditions énoncées dans le consentement de la Commission des services publics mentionnée à l'article 3 (2) (g) constituera le respect de toutes les lois relatives à la production. ou le transport d'énergie électrique [ou] l'utilisation ou l'occupation de terrains auxquels le projet Chalillo, ou sa conception, son financement, sa construction ou son exploitation peuvent être soumis, y compris, sans s'y limiter, la loi PUC et la loi sur l'électricité et aucun examen supplémentaire ou autre. , une audience, une évaluation, une approbation ou toute autre procédure en vertu de toute autre loi sera nécessaire pour autoriser ou permettre la conception, le financement, la construction et l'exploitation du projet Chalillo conformément au paragraphe (a) ;
(d) Pour éviter tout doute et pour plus de certitude, BECOL procédera à la conception, au financement, à la construction et à l'exploitation du projet Chalillo conformément aux paragraphes (a), (b) et (c) de la présente section, nonobstant tout jugement. , ordonnance ou déclaration d’une cour ou d’un tribunal, qu’elle soit accordée, délivrée ou faite antérieurement ou ultérieurement.
L'article 5 fait référence à l'article 68 de la Constitution du Belize et l'article 6 donne au ministre un large pouvoir de prendre des règlements.
24. Le Procureur général du Belize (qui, avec le Solicitor General, a assisté à l'audience devant la Commission, mais ne s'est pas adressé à la Commission) a déposé une déclaration sous serment concernant la loi de 2003. Entre autres choses, il a déclaré qu'à son avis, rien dans ce texte ne viole une quelconque disposition de la Constitution du Belize. Leurs Seigneuries n'ont pas entendu les arguments sur cette question car cela ne semblait pas nécessaire pour statuer sur la demande de mesures provisoires de BACONGO.
25. M. Fitzgerald (qui s'est adressé au Conseil au nom du DoE) a déclaré qu'il n'invoquait pas la loi de 2003 pour justifier que le Conseil ne devrait pas accorder d'injonction s'il estimait opportun de le faire. Il a également déclaré que le gouvernement du Belize obéirait à toute ordonnance du Conseil. Il a également évoqué la possibilité qu'une question constitutionnelle soit soulevée sommairement dans le cadre de nouvelles procédures au Belize. Ces questions devront peut-être être examinées plus en détail lors de l'audition de l'appel au fond de BACONGO. Leurs Seigneuries pensent qu'il vaut mieux se contenter de dire que le procureur général ne devrait avoir aucun doute quant à la gravité des problèmes potentiellement soulevés par la loi de 2003.
La demande au Conseil
26. La requête de BACONGO (qui a été préparée sous une certaine pression de temps) demande au Conseil d'exercer sa compétence inhérente pour préserver l'objet de l'appel en ordonnant l'arrêt des travaux de construction. Elle est étayée par un volume considérable d’affidavits. Ceux-ci comprennent un affidavit de M. Garel, président de BACONGO. La déclaration sous serment de M. Garel contient des photographies montrant que de vastes étendues de forêt ont déjà été abattues à proximité du barrage. Des véhicules lourds et des installations travaillent sur place. Selon la presse, environ 300 travailleurs sont sur place et doivent y être hébergés et entretenus.
27. À la preuve du requérant s'ajoute un volume beaucoup plus réduit de preuves (préparées dans des délais encore plus serrés) au nom des défendeurs. L'affidavit du procureur général a déjà été mentionné. L'autre élément de preuve important fourni par les intimés est une affirmation de leur agent du Conseil privé, M. Mireskandari, qui expose ce que lui a dit M. Young de BECOL. L'affidavit présente une description schématique du programme original du projet MRUSF et explique comment ce programme a été reporté.
28. Le programme est un document informatif et il aurait pu éviter beaucoup de temps et d'ennuis s'il avait été divulgué beaucoup plus tôt. Il montre que le plan initial prévoyait que le projet soit réalisé pendant deux saisons sèches et deux saisons humides, à commencer par la saison sèche de 2002, lorsqu'un batardeau devait être construit pour faciliter les travaux sur les culées du barrage. Un autre batardeau était prévu pour la saison sèche de 2003 pour la construction des exutoires du barrage et des structures auxiliaires en béton. La construction du barrage lui-même devait également avoir lieu pendant la saison sèche de 2003, impliquant des travaux 24 heures sur 24 pendant 40 à 50 jours.
29. M. Mireskandari a expliqué (sur les instructions de M. Young) que les travaux n'ayant commencé qu'après que la décision de la Cour d'appel ait été connue, ils accusaient un retard d'environ 14 mois. En prolongeant la construction du premier batardeau et des culées au-delà de la fin de la saison sèche, les entrepreneurs ont effectivement rattrapé leur retard d'environ deux mois. BECOL et ses sous-traitants ont désormais l'intention de poursuivre le programme comme auparavant, mais avec un an de retard. Le témoignage de BECOL indique que d'ici à ce que l'appel complet soit susceptible d'être entendu par la Commission, les opérations seront limitées au site du barrage, qui ne représente qu'environ 1/75ème de la superficie totale de la forêt tropicale qui sera affecté. Néanmoins, le site du barrage lui-même s’étend sur environ 25 acres.
30. Les principales questions qui préoccupent Leurs Seigneuries dans cette demande provisoire sont les suivantes :
(1) La Commission a-t-elle compétence (soit en première instance, soit par voie d'appel du refus de la Cour d'appel d'accorder des mesures provisoires) pour accorder une injonction interlocutoire interrompant les travaux sur le barrage ?
(2) Si la Commission est compétente, quels principes devrait-elle appliquer (notamment en ce qui concerne l’exigence ou la dispense d’un engagement croisé en dommages-intérêts) pour déterminer s’il y a lieu d’accorder une réparation ?
(3) BACONGO est-il un argument défendable et (si et dans la mesure où il est nécessaire de tenter une évaluation plus précise) quelle semble-t-il solide ?
(4) Quel point de vue la Commission devrait-elle adopter sur la prépondérance des inconvénients (ou sur les risques relatifs d'injustice d'un côté ou de l'autre) ?
Leurs Seigneuries examinent ces points tour à tour. Pour les raisons déjà évoquées, ils n’estiment pas nécessaire d’approfondir les questions soulevées par la loi de 2003.
Juridiction
31. La Cour d'appel a refusé de se déclarer compétente au motif que ses pouvoirs (dans la mesure où ils sont pertinents pour un appel devant la Commission) sont énoncés de manière exhaustive à l'article 9 de la Loi sur les appels du Conseil privé et que l'article 9 ne s'étend pas aux octroi d'une injonction contre un défendeur qui a obtenu gain de cause. M. Clayton a reconnu que l'article 9 avait une portée limitée. Il s’est plutôt appuyé sur les pouvoirs généraux conférés à la Cour d’appel en vertu de l’article 19(1)(a) de la Loi sur la Cour d’appel et en particulier sur ses derniers mots autorisant « toute ordonnance supplémentaire ou autre que l’affaire peut exiger ».
32. Leurs Seigneuries ne jugent pas nécessaire d'exprimer une opinion sur ce point. La Cour d’appel ayant décliné sa compétence, elle n’a pas considéré qu’elle disposait d’un pouvoir discrétionnaire à exercer et n’a exprimé aucune opinion sur la manière dont elle aurait pu exercer son pouvoir discrétionnaire. En Angleterre, la Cour d'appel est compétente pour accorder une injonction, même à un appelant qui n'a absolument pas réussi, en attendant un éventuel appel devant la Chambre des Lords (voir Polini v Gray (1879) 12 Ch D 438 et l'analyse des autorités par Megarry J. dans Erinford Properties Limited contre Cheshire County Council [1974] Ch 261, 266). Mais (indépendamment de la loi de 2003), il aurait été fort pour la Cour d'appel, qui a rejeté de manière unanime et décisive le cas de BACONGO, d'accorder une injonction en attendant un appel devant la Commission ; et il serait très irréaliste que la Commission tente de se mettre dans la position de la Cour d'appel en exerçant le pouvoir discrétionnaire que la Cour d'appel a refusé.
33. Il n'est pas nécessaire d'insister sur ce point puisque Leurs Seigneuries sont convaincues que la Commission elle-même a compétence pour accorder des mesures provisoires, le cas échéant, afin de garantir que toute ordonnance qu'elle rend lors de l'audition éventuelle de l'appel ne soit pas rendue sans effet. . L'exemple le plus clair et le plus évident est celui du sursis à l'exécution d'une condamnation à mort : voir Reckley contre Ministre de la Sécurité publique et de l'Immigration [1995] 2 AC 491. Leurs Seigneuries n'ont connaissance d'aucune décision rapportée dans laquelle la compétence aurait été discutée et exercé dans une affaire civile, mais ils sont convaincus qu’il existe et qu’il a été exercé de temps à autre. La compétence dépend du pouvoir de toute cour supérieure de superviser et de protéger ses propres procédures (voir Attorney General v Punch [2003] 2 WLR 49, en particulier les observations de Lord Nicholls of Birkenhead à la page 58). Ce pouvoir peut être qualifié de pouvoir inhérent, mais cela ne veut pas dire que ses origines sont dépourvues de fondement statutaire. Lorsque le Parlement a créé le Comité judiciaire du Conseil privé et a ensuite étendu ses pouvoirs par les lois sur le Comité judiciaire de 1833 et 1843, il faut considérer qu'il avait l'intention de conférer au Conseil tous les pouvoirs nécessaires au bon exercice de sa compétence d'appel.
34. M. Rabinder Singh QC (pour BECOL) s'est appuyé sur la décision de la Commission dans l'affaire Electrotec Services Limited contre Issa Nicholas (Granada) Limited [1998] 1 WLR 202 comme indiquant que la Commission n'a pas de compétence inhérente pour rendre des ordonnances accessoires. Mais cette décision concernait un pouvoir suggéré d'imposer des conditions restrictives (en ce qui concerne la garantie pour les frais) à un appelant qui avait un droit constitutionnel d'appel dans une affaire où la garantie pour les frais était déjà couverte par le code statutaire. Cela n'est en aucun cas incompatible avec le pouvoir inhérent ou implicite de la Commission de rendre des ordonnances accessoires dans le but de garantir qu'un appel, s'il est accueilli, ne soit pas rejeté.
Injonctions dans les affaires de droit public
35. Les avocats ont convenu (dans les termes les plus généraux) que lorsque le tribunal est invité à accorder une injonction provisoire dans une affaire de droit public, il devrait aborder la question dans le sens indiqué par la Chambre des Lords dans l'affaire American Cyanamid Company contre Ethicon Limited. [1975] AC 396, mais avec des modifications appropriées à l'élément de droit public de l'affaire. L’élément de droit public est l’un des possibles « facteurs spéciaux » mentionnés par lord Diplock dans cette affaire (à la page 409). Un autre facteur particulier pourrait être la question de savoir si l'octroi ou le refus de mesures provisoires était susceptible d'être, en termes pratiques, décisif pour l'ensemble de l'affaire ; mais aucune des deux parties n’a laissé entendre que la présente affaire entre dans cette catégorie.
36. L'approche de la Cour concernant l'octroi d'une injonction dans les affaires de droit public a été examinée (dans des circonstances particulièrement frappantes) par Lord Goff of Chieveley dans Queen v Secretary of State for Transport, ex parte Factortame Limited (No 2) [1991] AC 603. , 671-4. L’ensemble du passage appelle une étude attentive. Lord Goff a déclaré à la page 672 que, lorsque la Couronne cherche à faire appliquer la loi, il ne semble peut-être pas juste de lui imposer l'engagement habituel de dommages-intérêts comme condition à l'octroi d'une injonction. Lord Goff conclut (à la page 674) :
« Je suis moi-même d'avis que dans ces cas, comme dans d'autres, le pouvoir discrétionnaire conféré au tribunal ne peut être entravé par une règle ; Je doute respectueusement qu’il existe une règle selon laquelle, dans des cas comme celui-ci, une partie contestant la validité d’une loi doit – pour résister à une demande d’injonction provisoire contre elle, ou pour obtenir une injonction provisoire restreignant l’application de la loi – démontrent à première vue que la loi est invalide. Il est impossible de prévoir quelles affaires pourraient encore être portées devant les tribunaux ; Je ne peux pas écarter de mon esprit la possibilité (sans doute lointaine) qu'une telle partie puisse subir un préjudice si grave et irréparable dans le cas où la loi serait appliquée contre elle qu'il pourrait être juste ou commode d'en restreindre l'application par une injonction provisoire, même bien qu'il ne se soit pas acquitté d'un si lourd fardeau. En fin de compte, la question relève du pouvoir discrétionnaire du tribunal, compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire. Néanmoins, le tribunal ne devrait pas empêcher une autorité publique, par une injonction provisoire, d'appliquer une loi apparemment authentique à moins qu'il ne soit convaincu, compte tenu de toutes les circonstances, que la contestation de la validité de la loi est, prima facie, aussi solidement fondée que pour justifier une démarche aussi exceptionnelle.
37. Dans certaines affaires de droit public (telles que Queen v Servite Houses et Wandsworth LBC, ex parte Goldsmith (2000) 3 CCLR 354), la question est un simple litige entre un organisme public ou quasi-public (dans ce cas, un organisme de bienfaisance fournissant services de soins pour le compte d'une autorité locale) et les citoyens auxquels les services sont fournis. Dans un tel cas, une injonction peut être accordée au citoyen, sans aucun engagement de dommages-intérêts, si la justice l'exige. Swinton Thomas LJ a pris en considération l'importance publique de l'affaire, impliquant la fermeture d'une maison de retraite ; les conséquences très graves pour les résidents âgés et infirmes qui seraient déplacés des logements dans lesquels ils étaient installés ; leurs chances de succès lors de l'audience complète ; et la période relativement courte pendant laquelle l'injonction serait en vigueur en attendant l'audition de l'appel.
38. Dans l’affaire Queen c. Inspectorate of Pollution, ex parte Greenpeace Limited [1994] 1 WLR 570, en revanche, une organisation militante contestait une décision officielle dont la suspension aurait des conséquences financières négatives pour une société commerciale (British Nuclear Fuels PLC), qui n’était pas partie à la procédure. Brooke J avait refusé un sursis et la Cour d'appel a confirmé cette décision. Le juge juge Glidewell a déclaré à la page 574 :
« Lors de l'audience devant Brooke J, aucune offre n'a été faite par Greenpeace de s'engager quant aux dommages subis par BNFL si elle en subissait ; le genre d’engagement qui serait normalement requis si une injonction interlocutoire devait être accordée. Je garde à l'esprit que le juge a déclaré qu'il avait été influencé par la preuve selon laquelle Greenpeace serait probablement incapable de payer pour cette perte financière, mais il avait auparavant fait remarquer qu'aucun engagement ne lui avait été proposé. Si nous traitions de cette affaire uniquement sur la base des éléments dont dispose le juge, je n'y trouverais aucune difficulté. C’était essentiellement une question laissée à la discrétion du juge.
Scott LJ dit à la page 577 :
« Mais si le but de la suspension provisoire est, comme en l'espèce, d'empêcher l'action exécutive d'un tiers en vertu des droits qui ont été accordés par la décision attaquée, alors, à mon avis, il faut exiger un engagement croisé en dommages-intérêts. être accordée est, à titre discrétionnaire, une condition tout à fait admissible pour l’octroi de mesures interlocutoires et, en général, je pense, à moins qu’une caractéristique particulière ne soit présente, une condition dont on devrait s’attendre à ce qu’elle soit imposée.
Une approche similaire a été adoptée par le Tribunal foncier et environnemental de la Nouvelle-Galles du Sud dans l'affaire Jarasius contre Forestry Commission of New South Wales (19 décembre 1989). Certaines observations de Lord Jauncey of Tullichettle dans Queen v Secretary of State for the Environment, ex parte The Royal Society for the Protection of Birds [1997] Env LR 431, 440 sont également cohérentes avec l'opinion selon laquelle un engagement en dommages-intérêts devrait normalement être exigé. , même dans une affaire de droit public ayant des implications environnementales, si les intérêts commerciaux d'un tiers sont en jeu.
39. Les deux parties ont soutenu à juste titre que (en raison du large éventail d’affaires de droit public) le tribunal dispose d’un large pouvoir discrétionnaire pour suivre la voie qui semble la plus susceptible de produire un résultat juste (ou, pour formuler les choses de manière moins ambitieuse, afin de minimiser les conséquences). risque de résultat injuste). Dans ce contexte, M. Clayton a fait référence à la célèbre décision de la Cour d'appel dans l'affaire Allen contre Jambo Holdings [1980] 1 WLR 1252, qui a eu pour résultat qu'en Angleterre, une très grande catégorie de justiciables (c'est-à-dire les personnes bénéficiant d'une assistance juridique) ) sont naturellement exemptés de la nécessité de prendre un engagement croisé en dommages-intérêts. Cependant, leurs Seigneuries (sans jeter le moindre doute sur la pratique initiée par cette affaire) ne pensent pas qu'on puisse aller trop loin. Le tribunal n’est jamais exempté de l’obligation de faire de son mieux, dans le cas de requêtes interlocutoires ayant des implications financières considérables, pour minimiser le risque d’injustice. Dans Allen contre Jambo Holdings, Lord Denning MR a déclaré (à la page 1257) :
« Je ne vois pas pourquoi un plaignant pauvre se verrait refuser une injonction Mareva simplement parce qu'il est pauvre, alors qu'un plaignant riche l'obtiendrait ».
Compte tenu des faits de cette affaire, c’était un commentaire approprié. Mais il peut y avoir des cas où le risque de préjudice grave et non compensé pour le défendeur ne peut être ignoré. Le riche demandeur peut constater, s'il échoue finalement, qu'il doit payer une somme très importante pour avoir obtenu une injonction qui (avec le recul) n'aurait pas dû lui être accordée. Les avocats ont eu raison de convenir (conformément à toutes les autorités mentionnées ci-dessus) que le tribunal dispose d'un large pouvoir discrétionnaire.
Cas défendable
40. Bien que la Cour d'appel ait déclaré, en accordant l'autorisation d'appel, que cette affaire soulevait des questions d'importance publique, Leurs Seigneuries doivent se forger une certaine opinion sur la force ou la faiblesse de la thèse de BACONGO. Cela est particulièrement important lorsque, comme en l'espèce, l'octroi d'une injonction entraînerait une perte financière importante pour les intimés et qu'aucun engagement de dommages-intérêts n'a été offert. M. Clayton a soutenu que les affirmations des intimés concernant la perte doivent être traitées avec circonspection et que Leurs Seigneuries sont prêtes à supposer qu'elles ont peut-être placé leur cause trop haut. Néanmoins, un retard de quatre mois, avec environ 300 hommes et de grandes quantités de véhicules et d'équipements actuellement sur place, entraînerait forcément de graves perturbations et des pertes importantes. Il se peut qu'aux termes du troisième accord-cadre, toute perte incombe au gouvernement du Belize plutôt qu'à BECOL.
41. Comme nous l'avons déjà noté, la Cour d'appel n'était pas d'accord sur la nécessité d'une audience publique en vertu du Règlement 24. Mais (outre d'autres consultations publiques qui ont eu lieu en août 2001), une audience publique a maintenant eu lieu et (comme la Commission l'avait dit sans contradiction), le DoE a pris en compte les objections et les observations formulées lors de l'audience. Il semble peu probable que ce point ait encore beaucoup de poids. L'appel portera sur l'affirmation de BACONGO selon laquelle l'EIE était incomplète et défectueuse, notamment en raison de la nécessité d'enquêtes plus approfondies dans quatre domaines importants : la géologie (qui affecte la conception et la construction du barrage) ; l'hydrologie (y compris l'impact sur les établissements humains en aval) ; la faune et la flore; et des sites archéologiques. Leurs Seigneuries ne jugent pas approprié d'entrer dans les détails complexes de ces sujets, notamment parce que les deux parties ont décliné toute volonté de se lancer dans un procès sur affidavits. Un bref commentaire s'impose néanmoins.
42. Il est clair qu'il y avait une divergence d'opinion importante entre les géologues qui ont conseillé BECOL et le représentant du NEAC du Département de Géologie quant à la géologie du site du barrage. Cette différence, apparue plus tôt, a été discutée lors des réunions du NEAC en octobre et novembre 2001. Le résultat a été qu'un nouvel expert indépendant, le Dr Andrew Merritt, a été mandaté et que des investigations plus approfondies sur le site ont eu lieu avant que le DoE n'accorde l'autorisation environnementale. Cet aspect de la question est traité en détail aux paragraphes 27 à 33 du jugement de Rowe P en Cour d'appel. Il a conclu (paragraphe 33)
« Il s’agissait d’améliorer le « bien » et non de fermer les yeux des évaluateurs sur les dangers manifestes pour l’environnement. »
43. Rowe P a également examiné (aux paragraphes 37 et 48 de son arrêt) les trois autres domaines particuliers de plainte concernant l'insuffisance de l'EIE. Il a rejeté les plaintes. Il a cité (tout comme le juge en chef) le jugement du juge Cripps dans l'affaire australienne Prineas contre Forestry Commission of New South Wales (1983) 49 LGRA 402 :
« De toute évidence, le législateur a souhaité éliminer la possibilité d'une déclaration d'impact environnemental superficielle, subjective ou non informative et toute déclaration répondant à cette description ne serait pas conforme aux dispositions de la loi, de sorte que toute décision finale serait nulle. Mais, à mon avis, à condition qu'une étude d'impact environnemental soit exhaustive dans son traitement du sujet, objective dans son approche et réponde à l'exigence d'alerter le décideur et les membres du public ainsi que le ministère de l'Environnement et de l'Aménagement du territoire effet de l'activité sur l'environnement et les conséquences sur la communauté inhérentes à la réalisation ou à la non-réalisation de l'activité, elle répond aux normes imposées par la réglementation. Le fait que l’étude d’impact environnemental ne couvre pas tous les sujets et n’explore pas toutes les avenues préconisées par les experts ne l’invalide pas nécessairement ou n’exige pas qu’elle soit jugée non conforme pour l’essentiel à la loi ou aux règlements. En matière d’évaluation scientifique, il est douteux qu’une étude d’impact environnemental, dans la réalité pratique, puisse un jour aborder tous les aspects du problème. Il y aura toujours un expert prêt à nier l'adéquation du traitement et à souligner ses défauts ou ses carences.
Une étude d’impact environnemental n’est pas une fin décisionnelle en soi – c’est un moyen d’atteindre une fin décisionnelle. Son objectif est d’aider le décideur.
44. M. Clayton a soutenu que BACONGO dispose d'arguments solides en appel. Il s'est appuyé en particulier sur l'article 4(1) du Règlement, soulignant que les questions environnementales doivent être identifiées et examinées avant le début d'un projet. M. Fitzgerald a souligné les conclusions largement concurrentes du juge en chef Conteh et de la Cour d'appel, et a qualifié le cas de BACONGO de risible. Leurs Seigneuries n'acceptent certainement pas que le cas de BACONGO soit ridicule. Il s’agit d’une question qui préoccupe grandement le public, car elle implique une concurrence entre deux intérêts publics très importants. Mais malgré l'habileté avec laquelle M. Clayton a développé son dossier dans le temps limité dont il disposait, il ne semble pas à leurs Seigneuries que ce soit un dossier solide sur lequel demander, sans engagement de dommages-intérêts, une injonction qui mettrait fin à un projet de construction majeur pour quatre mois.
Balance des risques d’injustice
45. Le chantier du barrage est déjà un chantier très chargé. Des routes d'accès ont été construites, un grand nombre d'arbres ont été abattus et les culées du barrage ont été construites. Si aucune injonction n'est accordée, les travaux (restreints par la saison des pluies) se poursuivront jusqu'à l'audience d'appel en décembre. Il sera alors encore plus avancé et les dépenses totales engagées seront proportionnellement plus importantes. Mais si BACONGO obtient gain de cause en appel, il appartiendra à la Commission saisie de l'appel de déterminer quelle importance (le cas échéant) accorder au fait que les travaux seront en cours depuis environ six mois au lieu d'environ deux mois. Cela dépendra de l'opinion de la Commission saisie de l'appel quant à ce qu'exige la justice de l'affaire.
46. Leurs Seigneuries n'acceptent pas que BACONGO ait été coupable de retard dans la demande de mesures provisoires. Des retards ont eu lieu, mais ils sont dus principalement au fait que la Cour d'appel a refusé d'entendre la demande de mesures provisoires avant l'audition de l'appel au fond et s'est déclarée compétente pour connaître la nouvelle demande après le rejet de l'appel. La demande auprès du Conseil a été présentée rapidement. Le fait que les travaux sur le chantier se poursuivent depuis maintenant deux mois ne peut raisonnablement être attribué à une quelconque faute de la part de BACONGO. C’est néanmoins un fait dont il faut tenir compte.
47. Leurs Seigneuries ont conclu que l'octroi d'une injonction à ce stade entraînerait un plus grand risque d'injustice ultime que son refus. Ce conflit ne peut pas être décrit à juste titre comme un conflit entre intérêts publics et intérêts privés. Bien que BECOL appartienne au secteur privé, elle est très étroitement associée dans cette affaire au gouvernement du Belize (d'abord à travers les garanties et indemnités du troisième accord-cadre et maintenant aussi à travers la loi de 2003) et il existe des intérêts publics d'une réelle importance sur les deux côtés de l’argument. Les deux tribunaux inférieurs ont, bien que pour des raisons assez différentes, rejeté la contestation du projet par BACONGO. Il n’a pas été démontré que leurs raisonnements et leurs conclusions étaient mal fondés. De l'avis de leurs Seigneuries, il ne s'agit pas d'un cas dans lequel, en l'absence d'engagement de dommages-intérêts, il serait juste d'arrêter un projet majeur qui revêt une réelle importance pour l'économie du Belize.
Conclusion
48. Leurs Seigneuries ont déjà ordonné que Phyllis Dart (la présidente de la Belize Eco-Tourism Association, qui possède un lodge dans la jungle sur la rivière Macal) et Godsman Ellis (le vice-président, qui possède un hôtel sur la rivière) devraient être se sont jointes comme parties à la procédure. Leurs Seigneuries ont également déjà ordonné qu'il y ait une audience accélérée sur l'appel, et celle-ci a été fixée aux 3 et 4 décembre 2003. Pour les raisons exposées ci-dessus, Leurs Seigneuries considèrent qu'une injonction restreignant la poursuite des travaux sur le projet MRUSF jusqu'à ce que le l’audition de l’appel ne devrait pas être accordée. Les coûts de cette demande seront déterminés sur la base de soumissions écrites.